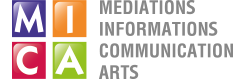Présentation de l’axe ATIIA
Responsables Cécile Croce, Vincent Liquète et Nicolas Nercam
Les chercheurs de l’axe ATIIA s’intéressent aux mutations et transformations des systèmes informatisés d’information et de communication, ainsi qu’aux transformations progressives de l’information (data, IA, IAg, information scientifique…). Une part des travaux porte sur les écosystèmes numériques et leurs mutations sociales, le design de dispositifs informationnels et les stratégies d’acteurs, les méthodes et outils d’analyses de l’usage des systèmes numériques, la médiation et la médiatisation des connaissances. L’équipe s’est attachée à promouvoir et à animer des réseaux à la fois de réflexion épistémologique sur les dispositifs et technologies informationnels et de recherche sur les enjeux et les usages engagés. Des recherches s’inscrivent directement dans l’analyse du lien et de l’articulation entre science et société. Une ensemble de partenaires régionaux, nationaux et internationaux sont associés à ces dynamiques de recherche. Le champ d’intervention de l’axe, qui touche aussi à la littératie informationnelle des jeunes, des séniors et des acteurs de l’Économie pour l’accompagnement de la transition numérique, participe du positionnement social du laboratoire.
Ces recherches sur les technologies numériques trouvent un écho dans divers secteurs d’activités et de création : les propositions des artistes contemporains qui conduisent à prendre de la distance (celle de la prise de conscience et de la réflexion) avec les usages et leurs enjeux. Les différentes stratégies mises en place par les artistes déployant l’esthétique dans une articulation serrée du contexte : dimension critique, activiste, hacktiviste, lanceur d’alerte, ironie ou humour, impostures, dimension de réparation et de soin, attention au commun, travail du collectif, …
Mots clés
pratiques informationnelles, pratiques documentaires, analyse des transitions, transition sociétale, transition environnementale, transition sociale, innovation technologique, innovation sociale, pratiques artistiques, protension, médiations artistiques, mutation sociale, écosystème numérique, transformation des connaissances, transition numérique, observatoire des pratiques, dispositifs artistiques, esthétiques technoscientifiques, ingérences créatives, intelligence artificielle, recherche-création
Membres de l'axe ATIIA
Doctorant·e·s
- ANGLES Magali
- BATIONO Kiedouanegnin Yvette
- CAO Runsen
- COMMISSO Graziella
- DE PLAEN Gaëtan
- DEBART Adrien
- DOK-KWADDA Eric
- DUBAIL Caroline
- EBANDA EBANDA Justin
- EL HAIK Sephora
- FAKHREDDINE Alexandre
- GARNIER Mathilde
- KONNECKE Maylis
- LAYOUNI Hiba
- LE TALLEC Tangi
- MOREAU Marine
- MOTTA RAMIREZ Oscar
- MOUSSAVOU NDJIMBIT Olivier Ange-Yannick
- NANTCHOUANG Bertine
- NGEMBI NGEMBI Damann Cherole
- RACHAD Salma
- RIBRIOUX Angéline
- SCAVINO Sébastien
- VENTURI DELPORTE Monica
Associé·e·s
- AIN Alexandra
- ATALLAH (BIDART) Sawsan Ghazi
- BECKMANN Valentine
- BOGUI Jean-Jacques
- BRUNEL DE MONTMEJAN Thomas
- CAPELLE Camille
- CAPES David
- CARRIÉ Jérome
- CHATEAU-CANGUILHEM Johann
- CHOQUET Isabelle
- CORBAL (ALBESSARD) Caroline
- COULIBALY Mohamed
- CRUBILÉ Marine
- DESJARDINS Marie-Laure
- DIAKHATE Diarra
- DUPONT Jérôme
- DUSSARPS Clément
- DUSSEAUT Fatma
- ENTRAYGUES Adeline
- ESCURIGNAN Julie
- FERRAND Mylène
- FETNAN Rime
- FOLLOT (NAVARRO) Murielle
- HERRERA NOLORVE (SUMALAVIA) Carmen
- LABARBE Emmanuel
- LACOMBE Éric
- LAGOUARDE Clément
- LAJUS Catherine
- LEHMANS Anne
- LENOEL Anne-Cécile
- LEVY Arnaud
- LIETART Armand
- LODOMBE Olga
- LORRE Benjamin
- LUBNAU WIMEZ Anne
- MARTINEZ Aurélie
- MARTY Patrik
- MBOA NKOUDOU Thomas Hervé
- MÉTAUX Sandra
- MICHET Florence
- MONTAGUT-LOBJOIT Myriam
- NKUNA WA NKUNA Charles
- NOUHAUD Nicolas
- PASCAU Julie
- PAUVERT Dominique
- POCEAN Andrada Doriana
- RAZANAKOLONA Livaniaina
- REMOND Émilie
- SOUMAGNAC Karel
- TURET Amélie
- TURKI Ramzi
- YONNET Aurore
Intentions scientifiques
Les chercheurs, les membres associés et les doctorants d’ATIIA sont engagés principalement autour de 5 domaines de recherche et de réflexion. Pour ce faire, ils mobilisent un ensemble de méthodes variées (allant de l’anthropologie des savoirs aux quantitatif et qualitatif), participent activement et régulièrement à l’édition scientifique (par le biais de revues de référence en sciences de l’information et de la communication (SIC) et en art, d’ouvrages, de collections de monographies, etc…) et valorisent les résultats de la recherche sous forme d’actions de médiation, de médiatisation, de valorisation, de transfert et de création permettant que les résultats de la recherche infusent puis entrent dans le champ social.
Les 5 domaines sont les suivants :
Représentations et Imaginaires
S’intéresser aux médias, aux technologies de l’info-communication, à la production et la médiatisation des connaissances, des images et de l’art, ainsi qu’aux contenus, textuels ou visuels en circulation sociale revient à s’intéresser à la production et à la diffusion des représentations sociales, des systèmes de valeurs, des idéologies, mais aussi à la façon dont les productions culturelles les mettent en question. Ainsi, afin de dépasser les seules approches centrées sur l’usage, l’utilisation, les conditions d’utilisabilité des dispositifs, les chercheurs d’ATIIA cherchent à repérer, analyser et produire une lecture critique des dynamiques, des discours et des modes de structuration de l’information, et des systèmes de pensée en action dans le domaine des industries culturelles, de l’information, des arts vivants en contexte numérique où se produisent et se diffusent les savoirs, les idéologies et les imaginaires du monde contemporain. C’est par ailleurs tenter de comprendre la portée critique des créations (artistiques, informationnelles, innovantes…) qui mettent en perspective ce contexte en travaillant les modalités représentationnelles, en élargissant les imaginaires en jeu dans leur dimension esthétique. Analyser la circulation des savoirs et des imaginaires exige de découvrir, décrypter, comprendre et critiquer les structures mythologiques et idéologiques des discours, les catégories des représentations informationnelles et artistiques, les constructions du sens des pratiques, des systèmes et des politiques par et avec le numérique. La question de la valorisation de nos analyses dans le champ social à travers des actions d’essaimage et de médiations par et au sein de la société est au cœur des préoccupations des chercheurs de l’axe.
Mutations et Transferts
Nos sociétés mondialisées ont été traversées par l’essor des technologies de l’information, de la communication et des transformations connexes des modalités et enjeux de la connaissance et de la création. Ainsi, le principe même de mutation et de transférabilité à d’autres secteurs ou domaines que celui des sciences humaines et sociales est un atout essentiel pour comprendre les sociétés contemporaines, et leur développement social tant du point de vue économique que politique et esthétique. Les politiques managériales et scientifiques sont marquées par la valeur de l’agilité, par laquelle l’innovation et la création de valeur deviennent des enjeux, alors que la notion même d’innovation se voit tantôt couplée à l’exigence de rentabilité, tantôt à celle de créativité, l’une n’excluant pas l’autre, en particulier par le développement des possibilités de diffusion. Parmi les transferts, on notera l’analyse de la qualité et de l’efficacité de la production de contenus, les performances des images diffusées, plus largement la pertinence de l’information en circulation sociale. Dans l’intensification des transferts, la dimension ethnocentrique des discours, des connaissances en circulation et des pratiques culturelles, notamment autour de l’art et plus largement des contenus informationnels est frontalement remise en question ; les approches culturelles et esthétiques traditionnelles sont notamment à repenser. Les technologies et le numérique jouent un rôle d’amplificateur des mutations en devenir.
Usages, pratiques et cultures
L’équipe interroge et analyse les phénomènes de mutations et transitions des pratiques info-communicationnelles et artistiques tout comme les usages des publics des médias, des documents traditionnels et numériques, des espaces de savoir comme les bibliothèques, les espaces documentaires, les nouveaux espaces de travail, de création et de diffusion artistique, les lieux inédits d’exposition et leurs médiatisations… ou émergents et/ou alternatifs comme les fablabs, les lieux de fabrication… Les chercheurs appréhendent notamment les impacts des contextes numériques et le développement des intelligences artificielles. Les communautés de pratiques et les cultures info-communicationnelles engagées, sont analysées sous un angle anthropologique, technique, social, numérique, poïétique, politique et esthétique. Les écosystèmes informationnels et numériques sont particulièrement considérés en retenant les phénomènes interactionnels, culturels et communicationnels. De même, les phénomènes émergents d’ingérence artistique, d’ «artivisme », ou encore, dans la continuité des mouvements d’art participatif, d’art en commun, d’art processuel, et les thèmes de postcolonialité et de décolonialité en art, d’attention au vivant et de phénomènes de transition, font l’objet d’un intérêt particulier de la part des membres de l’équipe. Le terme d’écosystème numérique peut être défini comme un ensemble dynamique composé d’acteurs (créateurs, producteurs, diffuseurs, usagers), de produits numériques (sites web, réseaux sociaux, plateformes, logiciels…), de combinaisons techniques et de méthodes plus ou moins élaborées et conscientisées, réinvesti dans toutes formes de production.
Patrimoines en construction
La question des patrimoines est centrale dans la construction et la définition de l’identité culturelle de tout groupe social. Il ne s’agit pas ici d’étudier le patrimoine historique, matériel ou immatériel, mais les phénomènes de patrimonialisation, leurs transformations et leurs transmissibilités. L’équipe ATIIA travaille sur les notions de patrimoine(s) numérique(s), mais également sur l’impact des intelligences artificielles sur la constitution de patrimoines culturels, informationnels et créatifs. Ainsi, il s’agit, par exemple, de répondre à la question de savoir quels sont les patrimoines culturels intégrés dans les bases de données dans lesquelles puisent les dispositifs de création à l’aide des IA, leurs transformations, les effets de leurs usages. Les modes d’organisation et de constitution innovants de ces patrimoines mouvants sont également appréhendés pour travailler entre autres sur les bases de données, les algorithmes, la créativité, l’intelligence collective et les communs de la connaissance et de la culture. L’axe ATIIA s’intéresse également au traitement artistique et conservatoire de la question des patrimoines en devenir, depuis les problématiques liées à la sélection des données et leur implémentation jusqu’à la remise en cause de la notion même.
Réceptions et Médiatisations
Enfin, les chercheurs de l’axe ATIIA analysent les conditions favorables et les obstacles à la réception des contenus culturels, des formes, des images et des œuvres. Les conditions de la réception, les obstacles et filtres sont considérés, tant au niveau des dispositifs de médiation, de médiatisation, qu’au niveau de la portée signifiante de l’œuvre elle-même. En effet, a minima, deux niveaux d’analyse sont considérés dans nos travaux : les activités mises en action pour médier les savoirs, les productions et les connaissances (la médiation), et les conditions d’accompagnement de ces activités par le biais de la mise en médias, de stockages et de diffusion (la médiatisation). Un troisième niveau d’analyse est celui de la dimension sensible des œuvres en fonction, d’une part, de leur processus de création, et d’autre part, dans une approche esthétique de la réception sur laquelle la médiatisation en jeu est en accord ou en tension. L’analyse poïétique et esthétique des créations artistiques renforce ainsi les questionnements des médiatisations et des médiations des contenus.