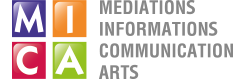Date/heure
06/06/2024 - 07/06/2024
8 h 45 - 18 h 15
Emplacement
la Maison de la Recherche - salle des thèses (001)
Catégories
Esthétique Minérale
Généalogie et enjeux contemporains
Colloque organisé par Bertrand Prévost (MICA) & Marina Seretti (SPH)
La pierre fascine autant qu’elle interroge. Des roches sidérales, sédimentaires et magmatiques aux pigments broyés, on la trouve aux origines de la vie sur Terre, au fondement de nombreuses religions, dans la main de l’homo faber, le poing du révolté, et jusque dans l’atelier de l’artiste.
Dans son De Statua, Alberti fait de la matière brute l’origine de l’art. La Nature sculptant à même « un tronc, une motte de terre ou d'autres corps bruts de cette sorte », il revient aux premiers artistes d’en poursuivre l’image inchoative. De fait, la texture, la forme et l’éclat propres à chaque pierre mettent au défi nos capacités de perception et d’imagination. De Pline à Caillois en passant par Cennino Cennini, certains voient dans les cailloux des montagnes en puissance, modèles-réduits de paysages sublimes autant qu’inaccessibles, d’autres y voient des images semblables à celles découvertes dans les nuages, mais qu’une lenteur extrême fait paraître immuables à nos yeux : « Rien ne change de forme comme les nuages, si ce n’est les rochers », déclare Victor Hugo dans L’Archipel de la Manche. En ce sens, les matières minérales s’avèrent éminemment poïétiques, matrices inépuisables de couleurs et de formes, douées d’expressivité, voire littéralement « génitrices » si l’on se réfère aux croyances vitalistes qui ont durablement entouré leur croissance et leur sexualité.
De l’image dans la pierre à la pierre comme image de l’art – un « art brut » selon Charlotte Perriand et Fernand Léger –, il n’y a qu’un pas, diversement franchi en Chine comme en Occident, que l’on songe aux gongshi (rochers de lettrés) et aux pierres de rêves, à l’agate fabuleuse de Pline l’Ancien (où l’on pouvait admirer Apollon et les neuf muses) et aux paesine d’Antonio Tempesta, ou bien encore à la pierre d’achoppement du Facteur Cheval, au cristal habité par André Breton et aux pierrespoèmes de Roger Caillois. Par leur capacité à susciter des images, à la fois ambiguës et durables, les pierres nous confrontent au délicat nouage de l’oeil et de la matière. Elles nous font entrer à nouveaux frais dans ce laboratoire secret où naît la variété des formes et où s’opère leur passage à l’art.
Cette puissance métamorphique propre aux pierres n’est pas seulement d’ordre poétique. Elle désigne un processus de mutation physique qui s’inscrit dans le temps profond des ères géologiques voire de la formation de l’univers. Matière-mémoire d’un temps qui nous déborde de toute part, à la fois premier et dernier, la pierre nous porte à concevoir « l’univers sans l’homme » (Baudelaire). Ces « archives suprêmes », comme les appelle Roger Caillois, « ne perpétuent que leur propre mémoire » : « mystère plus lent, plus vaste et grave que le destin d’une espèce passagère » (Pierres, 1966). Les plus anciennes d’entre elles nous invitent à contempler un temps plus et autre qu’humain, celui-là même que Quentin Meillassoux nomme « ancestral », puisqu’il indique « l’existence d’une réalité ou d’un événement […] antérieur à la vie terrestre » (Après la finitude, 2006). « Archifossile ou matière-fossile », la pierre nous met alors sur la voie d’un réalisme capable de faire place à une forme radicale d’objectivité, c’est-à-dire de prendre en charge les énoncés scientifiques (à commencer par ceux de la géologie et de l’astronomie) qui échappent à la corrélation du sujet et de l’objet, et qui excèdent la présence au monde du sujet qui les formule. En d’autres termes, la contemplation des pierres met en cause l’esthétique et l’interroge de toutes parts : comme théorie du sensible autant que de l’art et du beau.
Des monumentales earthworks de Robert Smithson à la minimale bouchée d’aragonites d’Evariste Richer (Je suis une caverne, 2010), en passant par le très médiatique voyage au centre de la Terre d’Abraham Poincheval (Palais de Tokyo, 2017), l’esthétique minérale creuse de multiples sillons dans l’art contemporain. En témoignent de récentes expositions comme Le précieux pouvoir des pierres à Nice (2016), Être pierre au Musée Zadkine (Paris, 2018) et, en ce moment même, Histoires de pierres à la Villa Médicis (Rome, 2023-2024). C’est à cette fascination à la fois très ancienne et très actuelle de l’art pour les pierres que le présent colloque entend faire place. Il s’agira d’entrer dans les raisons de cette fascination, d’en esquisser les contours contemporains et la généalogie à travers certains jalons privilégiés (les moments renaissant et romantique notamment), enfin d’interroger la nature et la cohérence d’une « esthétique minérale » prise entre l’expressivité et l’ancestralité de ses objets, leur puissance d’évocation et leur emblématique objectivité.