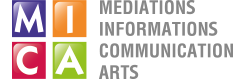Date/heure
26/08/2025
Catégories
Technologies de l’enchantement
Astasa - Saison 2025-2026
sous la direction de Cécile Croce et Marie-Laure Desjardins
« Le propre de l’homme est son inexplicable besoin de merveilleux. Et c’est là le point le plus aigu de son divorce avec la nature. On ne croit plus aux miracles – rien de plus évident. Mais les miracles auxquels on ne croit plus ne sont rien au prix de ceux que tout homme porte en réserve au fond de soi et que son imagination lui offre, à tous moments, à fleur de tête. » Pierre Reverdy, Le Livre de mon bord. Notes 1930-1936.
Introduction
Le nouvel appel à contributions d’Astasa propose d’examiner le merveilleux dans les pratiques artistiques actuelles impliquant les sciences et les technologies. Son titre est une référence directe aux travaux de l’anthropologue anglais Alfred Gell, qui montre comment les artefacts (notamment dans les cultures traditionnelles) sont investis de pouvoir par leurs qualités techniques et comment ces dernières participent de leur capacité à étonner, fasciner, voire sidérer. Par cette fascination, selon l’auteur de « The Technology of Enchantment and the Enchantment of Technology1 », les objets d’art « piègent » et « ravissent » le spectateur, le « saisissent » (GELL : 2009, p. 23). Admiratif des prouesses techniques opérées dans l’œuvre, confronté à la matérialisation d’une « agentivité essentiellement indéchiffrable » (ibid., p. 71), au résultat d’une transformation, voire d’une « transsubstantiation », de l’objet passé dans le monde de l’art, le spectateur est comme ensorcelé par ce qui est offert par l’artiste et semble tenir du miracle. Attitude mentale humaine spécifique (DERLON et JEUDY-BALLINI : 2010) ou ruse particulière de l’art ? Le miracle tient du merveilleux. En mobilisant les techniques les plus avancées, l’artiste ne renforce-t-il pas cette part miraculeuse de l’œuvre, tandis que les œuvres, par leurs dispositifs sophistiqués, leurs interfaces, leurs algorithmes, réenchantent l’expérience sensible ?
Le merveilleux naturel
Lorsqu’artistes et scientifiques sont invités à « penser la nature » avec l’art, celui-ci « soulignant » et « sublimant » les merveilles de celle-là2, le miracle semble changer de source, l’artiste devenant son opérateur, son agent ou son médiateur. Avec Passage3, Cornelia Konrads dessine en pleine nature une porte, une invitation à la découverte, et marque un seuil – non pas tant depuis le monde ordinaire vers le monde de l’art, mais sans doute depuis la nature supposée connue vers celle rendue à ses richesses, ses mystères, ses magies, grâce à l’art. Promis à des surprises, le visiteur est surtout attiré par l’inconnu, guidé vers ce qu’il n’attend pas, une émotion nouvelle ou un objet de connaissance inédit.
Plutôt que de risquer la rencontre inopinée ou guidée de l’émerveillement, chacun peut tout aussi bien être tenté de collectionner les merveilles et de les tenir en indices du monde. Ainsi, comme le note l’historien de l’art et commissaire d’exposition Jean-Hubert Martin, « [l]es Wunderkammer (cabinets des merveilles) de la Renaissance regroupaient toutes sortes d’objets étranges et bizarres qui servaient de témoins ou de pièces à conviction pour essayer de comprendre le monde et de lui donner une interprétation et un sens qui ne soit plus uniquement celui de la Bible4 ». Naturalia ou artificialia, les merveilles pouvaient être admirées ou étiquetées et classifiées. Avec le « remplacement de l’exceptionnel par l’usager dans la réflexion, se profilait le rationalisme qui mettait fin à l’enchantement », écrit encore Martin.
En s’éloignant de l’objet à collectionner que constituent la merveille ou les merveilles – du latin mirabilia : « choses admirables » (neutre pluriel de mirabilis, « merveilleux »), prodige, frappant d’étonnement, dans le registre de l’horreur ou, au sens plus contemporain, dans celui de l’enchantement. L’humain goûte et sent ce qui étonne et paraît admirable en dehors de toute saisie par les sciences ou la raison : l’inexplicable merveilleux, ce qui est en dehors de la réalité et ce qui y apparaît. Ainsi l’objet échappe, qu’il soit associé à une curiosité insatiable, motrice de la recherche, ou à des procès inconscients, tels qu’ils pouvaient fasciner les surréalistes en leurs œuvres. « Le merveilleux est toujours beau, n’importe quel merveilleux est beau, il n’y a même que le merveilleux qui soit beau », écrivait André Breton dans le Manifeste du surréalisme en 1924. Le merveilleux emprunte alors à souhait la voie de la poésie, de l’écriture automatique, et bientôt les artistes interviendront directement en pleine nature. Comment s’écrit la chaîne qui va du merveilleux au beau et du beau à la science et comment nommer ce qui, entre eux, circule ? Associé à Dieu, au miracle, au talent de l’artiste, à la curiosité, au désir de savoir, à la dynamique de l’inconscient, à l’imagination, à une lecture scientifique du monde ou aux inventions de l’esprit, le merveilleux frôle, d’un côté, l’enchantement et, de l’autre, le risque de perdre pied ou de perdre raison. Que deviennent ces associations, lorsqu’elles sont revisitées avec les technosciences ?
Le merveilleux technoscientifique
Aujourd’hui, le merveilleux se recompose au contact des technologies numériques, biotechnologiques et computationnelles, qui lui offrent de nouveaux modes d’inscription dans le sensible et le récit. Ce n’est plus uniquement par le biais de figures surnaturelles ou de mondes imaginaires que le merveilleux s’actualise, mais à travers des dispositifs techniques capables de produire des effets d’apparition, de surprise et d’altérité. De nombreuses œuvres immersives, installations interactives et autres dispositifs impliquant des entités non humaines – qu’il s’agisse de drones, d’algorithmes ou de micro-organismes – donnent lieu à des formes d’expérience qui réactivent les dimensions fondamentales du merveilleux : l’étonnement face à l’inattendu, la fascination pour l’inexplicable et le trouble né d’une perception élargie du réel.
Cette reconfiguration technologique du merveilleux ne constitue donc pas une rupture radicale, mais une transformation de ses modalités d’émergence. Comme le montraient déjà les cabinets de curiosités, le merveilleux a toujours trouvé, dans les artefacts, un terrain d’expression privilégié. Aujourd’hui, ce sont les intelligences artificielles génératives, les interfaces immersives ou les écosystèmes interactifs qui jouent ce rôle. Des propositions artistiques, comme la sculpture Melting Memories (2018) de Refik Anadol, qui convertit des données neuronales en tableaux augmentés, ou l’installation-performance Subassemblies (2013-2016) de Ryoichi Kurokawa, qui transforme (à partir de données scannées en 3D) ruines industrielles et environnements naturels en architectures chimériques visuelles et sonores, traduisent une fascination renouvelée pour l’apparition et la métamorphose. Ces œuvres prolongent l’héritage du merveilleux, mais en l’inscrivant dans une esthétique de l’émergence qui privilégie le processus plutôt que le résultat, la mutation plutôt que la forme arrêtée.
Le merveilleux, ainsi reconfiguré, mobilise la technologie non comme simple outil, mais comme milieu opératoire de l’expérience esthétique. L’apparition n’y est pas seulement perceptible par la vue, elle engage le corps, l’espace, la temporalité du spectateur. Elle est une scène d’interférence entre nature et culture, humain et non humain, visible et invisible. L’irruption d’une image algorithmique, la chorégraphie d’un essaim de drones comme la transformation d’un espace sous l’action d’un capteur de mouvement ne sont pas seulement des effets spectaculaires, mais interrogent les capacités d’un espace peuplé d’agents artificiels. Le merveilleux y est moins une échappée qu’un mode d’interprétation du présent, un instigateur de sens dans un contexte où la technicité envahit l’imaginaire.
Ces formes technologiques du merveilleux en approfondissent les dimensions à la fois affectives et cognitives. L’émerveillement qu’elles suscitent engage une réflexion critique sur notre manière de percevoir, de sentir, et de penser les mondes que nous habitons. Dans AI Art: Machine Visions and Warped Dreams (2020), la chercheuse et artiste britannique Joanna Zylinska montre comment certaines œuvres créées avec ou par des intelligences artificielles fonctionnent comme des récits de perception altérée : ce sont des « rêves déformés » (warped dreams) où les algorithmes ne reproduisent pas simplement le visible, mais l’interprètent, le filtrent et le reconfigurent selon des logiques qui échappent aux schémas cognitifs habituels. Ces œuvres ouvrent un espace ambigu, à la fois fascinant et dérangeant, où la machine devient productrice de fiction autant que révélatrice des biais, des imaginaires ou des fantasmes technologiques contemporains.
Joanna Zylinska insiste cependant sur le fait que ce merveilleux algorithmique ne doit pas être perçu naïvement comme une simple célébration de la puissance machinique. Il constitue aussi un terrain critique en ce qu’il met en lumière les enjeux idéologiques, économiques et politiques sous-jacents à la production d’images par les IA. Ces « visions de machine » sont également des visions sur la machine : elles questionnent ce que nous projetons en elle, ce que nous attendons d’elle et ce que nous lui déléguons. Ainsi, le merveilleux technologique apparaît comme un phénomène ambivalent : à la fois poétique, en ce qu’il déstabilise nos manières de voir, et critique, en ce qu’il nous oblige à interroger les conditions – techniques, culturelles, symboliques – de ces nouvelles formes d’apparition. Dans ce contexte, le merveilleux devient un espace de friction entre enchantement et lucidité, imaginaire augmenté et vigilance épistémologique.
La fabrique de l’enchantement
Inspirées par les travaux d’Alfred Gell sur les « technologies de l’enchantement », les prochaines publications d’Astasa interrogeront la façon dont les dispositifs techniques et technoscientifiques – intelligence artificielle, réalité augmentée, installations immersives, générateurs d’images ou de sons, etc. – permettent de fabriquer de l’enchantement, d’engendrer des expériences perceptives et de réactiver une poétique de l’apparition. La création de ces formes inattendues, figures instables ou présences fugitives, souvent à la lisière du visible et du sensible, ne produit pas simplement des effets visuels ou narratifs. Elle engage une expérience où l’image, le son, la matière, semblent se manifester de façon presque autonome.
Loin d’un retour au merveilleux premier, il s’agit d’en penser les mutations contemporaines, entre émerveillement et effroi, simulation et fiction. Le merveilleux n’est plus seulement l’indice d’un monde au-delà du monde, mais devient un opérateur critique qui expose les limites de notre perception, la plasticité de la réalité ou encore la malléabilité du vivant et du sensible. En ce sens, il engage une réflexion éthique et esthétique sur les conditions de l’apparition à l’ère technologique : que signifie aujourd’hui « faire apparaître » ? Qu’est-ce qu’un phénomène qui nous touche, nous dépasse ou nous transforme ? Et que peut encore l’art face à ces machines qui semblent capables de tout, même du merveilleux ?
Nous souhaitons notamment aborder les problématiques suivantes :
Axe 1. Apparitions technologiques : formes sensibles du surgissement
Motif central du merveilleux depuis l’Antiquité, l’apparition se déploie aujourd’hui dans des contextes technologiques où les frontières entre réel et virtuel sont brouillées. Les arts numériques, immersifs, interactifs ou assistés par IA produisent des expériences d’apparition qui convoquent l’étonnement, la perte de repères, la fascination. Que se passe-t-il quand une image se génère sous nos yeux, quand un avatar nous répond, quand une forme surgit d’un calcul algorithmique ? Cet axe invite à interroger les formes contemporaines de l’apparition comme événement esthétique, à la croisée du visible, du machinique et de la présence simulée.
Axe 2. Merveilleux et technosciences : aux pays des hybridations et des métamorphoses
La rencontre du merveilleux et des technosciences engendre une nouvelle esthétique de l’étrange : créatures post-humaines, êtres synthétiques, environnements vivants simulés ou modifiés. Microbiologie, robotique, informatique, deviennent autant de leviers d’imaginaire et de fiction. Dans les œuvres d’Eduardo Kac ou de Lucy McRae, par exemple, le merveilleux se donne à voir comme forme radicale d’altérité. Cet axe propose de réfléchir aux métamorphoses contemporaines, aux enjeux symboliques, poétiques, politiques de l’hybridation, en dialogue avec les avancées scientifiques.
Axe 3. Artefacts du merveilleux : objets, dispositifs, matérialités
Loin de n’être qu’un effet, le merveilleux est une construction matérielle, reposant sur des objets, des dispositifs, des mécanismes. Depuis les cabinets de curiosités jusqu’aux installations interactives, les objets techniques jouent un rôle décisif dans la mise en scène de l’extraordinaire. Comment ces dispositifs matérialisent-ils l’impossible ? Quel rôle jouent-ils dans la production d’un effet de merveilleux ? Du diorama à la sculpture 3D, cet axe s’attache aux formes concrètes du merveilleux, aux technologies de l’apparition, aux mises en scène de la surprise.Modalités de proposition
Les personnes souhaitant soumettre un article (comptant entre 10 000 et 30 000 signes) sont invitées à envoyer un résumé (de 250 mots) et une courte biographie (de 150 mots) conjointement à cecile.croce@iut.u-bordeaux-montaigne.fr et mldesjardins@artshebdomedias.com
Les propositions peuvent être soumises jusqu’au 26 août 2025.
Une réponse sera donnée rapidement.
Les dates de remise des textes sont fixées au 27 octobre 2025, 5 janvier 2026, 7 avril 2026 et 8 juin 2026. Elles correspondent à des publications en décembre 2025, mars 2026, juin 2026 et septembre 2026. Merci aux auteurs d’indiquer leur préférence dans leur mail.
Bibliographie
- ALMIRON Miguel, BAZOU Sébastien, PISANO Giusy (dir.) (2020), Magie numérique. Les Arts trompeurs. Machines. Magie. Médias, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion.
- BAZIN André (2002), Ontologie de l’image photographique (1945), dans Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Cerf.
- BORGES Jorge Luis (1957), Le Livre des êtres imaginaires, Paris, Gallimard.
- CHÂTEAU Dominique et AUBRAL François (1999), Figure, figural, Paris, L’Harmattan, 1999.
- COSTA Mario (1994), Le Sublime technologique, Lausanne, Iderive.
- COUCHOT Edmond (2002), La Technologie dans l’art. De la photographie à la réalité virtuelle, Nîmes, Jacqueline Chambon.
- COUTÉ Pascal, FRAZIK Hélène, PRUNET Camille (2020), L’Apparition dans les œuvres d’art, Caen, Presses universitaires de Caen.
- DERLON Brigitte et JEUDY-BALLINI Monique (2010), « L’art d’Alfred Gell. De quelques raisons d’un désenchantement », L’Homme, n° 193. [En ligne] <https://journals.openedition.org/lhomme/24354>
- DUFOUR Hugues (2024), La Beauté sous algorithmes. Quand la machine bouscule nos codes culturels, Limoges, FYP Éditions.
- FISCHER Hervé (2014), La Pensée magique du Net, Paris, François Bourin.
- FISCHER Hervé (2000), « Mythanalyse du futur », publié en accès libre sur le Web. [En ligne] <http://www.hervefischer.net/docs/mythfinal.pdf>
- GELL Alfred (2009), L’Art et ses agents. Une théorie anthropologique, Dijon, Les Presses du réel.
- HEIDEGGER Martin (1980), Introduction à la métaphysique, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1980.
- HENRY Michel (1990), Phénoménologie matérielle, Paris, PUF.
- HUSSERL Edmund (1985) Idées directrices pour une phénoménologie (1950), traduction de l’allemand de Paul Ricœur, Paris, Gallimard, coll. « Tel ».
- LAFON Jacques (2000), Esthétique de l’image de synthèse. La trace de l’ange, Paris, L’Harmattan.
- MANOVICH Lev (2010), Le Langage des nouveaux médias, Dijon, Les Presses du réel.
- REVERDY Pierre (1989), Le Livre de mon bord (Notes 1930-1936) (1948), Paris, Mercure de France.
- SCHAEFFER Jean-Marie (2015), L’Expérience esthétique, Paris, Gallimard.
- VERGELY Bertrand (2010), Retour à l’émerveillement, Paris, Albin Michel.
- ZYLINSKA Joanna (2020), AI Art: Machine Visions and Warped Dreams, Open Humanities Press CIC.
1. « The Technology of Enchantment and the Enchantment of Technology », publié en 1992 et repris dans Art and Agency: An Anthropological Theory, Oxford University Press, 1998. La traduction française a été éditée par les Presses du réel, en 2009, sous le titre L’Art et ses agents. Une théorie anthropologique.
2. Voir « Le Merveilleux au cœur de la nature », Conversations sous l’arbre, Chaumont-sur-Loire, 28 et 29 septembre 2023.
3. Informations sur le site du Domaine de Chaumont-sur-Loire, où l’œuvre est installée dans le parc historique depuis 2015. [En ligne] <https://domaine-chaumont.fr/fr/centre-d-arts-et-de-nature/archives/saison-d-art-2015/cornelia-konrads>
4. Extrait du livret des Conversations sous l’arbre, 28 et 29 septembre 2023. L’intervention de Jean-Hubert Martin est accessible (comme celles de Christian Vergely, d’Étienne Klein, d’Anne et Patrick Poirier) sur la chaîne YouTube des rencontres : <https://www.youtube.com/@Conversationssouslarbre>