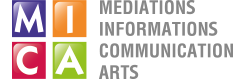Date/heure
30/12/2025
Catégories
Penser le rapport à l’IA et aux technologies numériques : pouvoirs, résistances, innovations
Colloque international de la Chaire Unesco « Pratiques émergentes en technologies et communication pour le développement »
émis par la chaire PETCD et le laboratoire MICA
Présentation
Les technologies numériques constituent un facteur central de mutation des sociétés contemporaines, l’intelligence artificielle représentant l’un de leurs vecteurs les plus significatifs. Elles sont à la fois porteuses de promesses d’innovation et de participation, et vectrices de dépendances, d’exclusions et de formes renouvelées de domination. Nonobstant l’avis de Richard G. Zind (1978), aucune technologie n’est neutre (Goupy, 2014 ; Almazán Gómez & Luzi, 2020,). Les modèles en circulation, malgré leur prétention à l’universel sont porteurs de références culturelles et de cadres cognitifs particuliers. Ils privilégient des sources et des cadres normatifs propres à leur univers symbolique et social. Tant et si bien que lorsqu’on adopte une technologie, on adopte par le fait même, qu’on le sache ou non, la culture, les références, les pratiques induites… de son fabricant. Bien entendu, tout dépend ensuite du comportement de l’agent. Soit, il l’intègre et l’érige en modèle absolu ou type-idéal, sans le discuter. Soit, il se l’approprie en en détournant les usages et les fonctions ou plus fondamentalement en le recréant à partir de ses propres références culturelles, ses cadres cognitifs, et/ou à partir de ses besoins et ses attentes spécifiques. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas perdre de vue que tout modèle, qu’il soit descriptif, normatif-analytique, type-idéal ou purement normatif à imiter, selon les catégories de Jean-François Ménard (2006), aspire à s’imposer comme modèle de référence, même, et à plus forte raison, en situation de concurrence. Mais l’on sait aussi que, qu’on le veuille ou non, l’adoption d’un modèle implique toujours aussi des déviances et des appropriations. On assiste souvent à une reconstruction initiale puis à un éloignement (Darbon, 2009) au point où le modèle importé devient ni plus ni moins « the way we do things here », comme le souligne Richard Rose (1991, 29).
Les approches critiques issues des pensées postcoloniale et décoloniale permettent d’éclairer ces ambivalences. Se plaçant du point de vue des logiques globales liées à la régulation politique et sociale favorisée par le transfert de modèles, elles révèlent la persistance de mécanismes de domination hérités de l’histoire coloniale participant de la mise en forme des représentations sociales par la fabrique sociale locale et, à ce titre, contribue à la cannibalisation des modèles locaux. Appliquée au domaine du numérique et de l’IA, la pensée décoloniale invite à voir reproduites dans les infrastructures numériques, ces logiques à l’oeuvre dans l’extractivisme des données, la concentration algorithmique, la gouvernance des plateformes (Quijano, 2000 ; Mignolo & Walsh, 2018). La fracture numérique, loin de se réduire à une question d’accès technique, renvoie à des inégalités culturelles, linguistiques et épistémiques qui maintiennent des populations entières à la marge des dispositifs numériques (Oyedemi & Choung, 2020).
La pensée décoloniale montre en même temps que ces technologies ne sont pas uniquement des instruments de reproduction des hiérarchies globales. Elles constituent également des espaces de réinvention et de résistance. Dans de nombreux contextes, des initiatives citoyennes et communautaires mobilisent le numérique pour défendre des savoirs locaux, réaffirmer des identités culturelles et expérimenter des formes alternatives de gouvernance. L’activisme numérique, les radios communautaires, les réseaux citoyens ou encore les usages créatifs des plateformes témoignent de la capacité des acteurs à détourner et se réapproprier le numérique (Castells, 2012 ; Escobar, 2018).
L’innovation frugale (Radjou, Prabhu & Ahuja, 2012), qui s’appuie sur la créativité contextuelle et les ressources locales, illustre cette réinvention. Qu’il s’agisse des Fab Labs africains (Nkoudou, 2022), des systèmes de paiement mobile ou des cartographies participatives autochtones (Damome, Akam et Kiyindou, 2019), ces pratiques montrent que d’autres formes de technologies, adaptées aux contextes et pensées pour les besoins des communautés, sont possibles (Kiyindou, Damome et Akam, 2022).
Enfin, la question de l’éducation et de la transmission critique des savoirs demeure centrale. Inspirées par les pédagogies critiques (Freire, 2013), des pratiques éducatives et participatives visent à dépasser une vision techniciste pour développer une appropriation réflexive et émancipatrice du numérique. Loin d’un simple apprentissage technique, il s’agit de construire une capacité collective à interroger les logiques de surveillance, de dépendance et d’exclusion, et à imaginer des alternatives (Santos, 2011).
Ce colloque se propose d’explorer ces tensions, en croisant approches critiques, études de terrain et perspectives théoriques sur l’intelligence artificielle, les technologies numériques et leurs usages dans la communication, la gouvernance et le développement.
Axes thématiques
Les propositions pourront s’inscrire dans les axes suivants :
1. Gouvernance, circulation des savoirs, souveraineté des données
Cet axe interroge dans un premier temps la manière dont les technologies numériques façonnent les régimes de gouvernance et participent à la hiérarchisation ou à la circulation des savoirs. Les plateformes globales, dominées par quelques multinationales, exercent consciemment ou inconsciemment un pouvoir de sélection et de visibilité qui contribue à l’invisibilisation de savoirs locaux, de langues minoritaires ou de récits alternatifs. Dans le même temps, des expériences communautaires de gouvernance numérique montrent que des modèles de circulation des savoirs plus horizontaux sont possibles. Les communications pourront explorer la tension entre hégémonie et alternatives dans les politiques, dispositifs et infrastructures du numérique.
La fracture numérique dont il est question ne se réduit pas à l’infrastructure (accès à Internet, aux équipements), elle recoupe aussi des inégalités culturelles, linguistiques et épistémiques. Les technologies globales sont souvent conçues sans prise en compte des réalités locales, contribuant à marginaliser des communautés entières. Cet axe explore donc également comment ces fractures renforcent des exclusions déjà héritées du colonialisme. Les communications pourront également montrer comment des initiatives éducatives, culturelles ou citoyennes cherchent à réduire les inégalités. Les communications pourront, par exemple, analyser la faible connectivité dans les écoles rurales, l’absence de contenus numériques dans certaines langues, ou encore l’impact de l’exclusion numérique sur la participation civique et culturelle.
Cet axe invite par ailleurs à interroger les enjeux de souveraineté numérique : comment redonner aux communautés et aux États la maîtrise de la collecte, du stockage et de l’exploitation des données ? L’on peut regretter ce qui est appelé « colonialité des données » c’est-à-dire la captation massive des traces numériques par des acteurs globaux, souvent au détriment des pays du Sud. Cette situation pose un double problème : d’une part, elle limite la capacité des pays concernés à développer leurs propres stratégies de valorisation des données ; d’autre part, elle alimente une dépendance structurelle vis-à-vis d’acteurs privés transnationaux qui imposent leurs normes, leurs infrastructures et leurs logiques commerciales. Il s’agit donc de réfléchir à la mise en place de cadres de gouvernance qui garantissent la protection des données personnelles, la transparence des usages et l’accès équitable aux ressources numériques. Cela suppose aussi d’investir dans des infrastructures locales – centres de données, solutions de cloud souverain, réseaux sécurisés – qui soient adaptées aux contextes culturels, linguistiques et socio-économiques des pays du Sud. Quelles alternatives locales émergent pour construire des infrastructures respectueuses des droits, de l’éthique et des besoins locaux ?
2. Épistémologies et pédagogies critiques du numérique
Cet axe s’intéresse au dépassement de la vision techniciste de l’apprentissage numérique pour développer des capacités critiques, permettant d’interroger les logiques d’exclusion, de surveillance et de domination. Il invite à la réflexion à des pratiques éducatives et de recherche qui rendent les communautés actrices dans l’appropriation technologique. Les communications pourront analyser des expériences d’éducation populaire, d’universités communautaires ou de dispositifs participatifs de formation, où le numérique devient outil de conscientisation et de libération.
Mais cet axe vise également à susciter une réflexion autour des savoirs situés. Partant du constat des risques liés à la reproduction des biais culturels, linguistiques et sociaux, de surveillance accrue et d’extractivisme des données, il s’agit d’interroger les logiques d’inégalités et de marginalisation et en même temps que les formes de résistances et d’appropriations critiques du numérique et de l’IA. Il invite à explorer les alternatives possibles vers une IA éthique qui intègre des épistémologies et des valeurs issues des Suds. Les communications pourront porter aussi bien sur des approches théoriques que sur des études de cas, notamment dans les domaines de la gouvernance, de la santé, de l’éducation, de la culture ou des mobilisations citoyennes.
3. Innovation frugale et technodiversité
L’innovation frugale désigne la capacité à inventer des solutions efficaces dans des contextes de ressources limitées, souvent à travers le recyclage, le bricolage ou les pratiques collectives d’ingéniosité. Cet axe met en valeur des expériences comme les Fab Labs, les systèmes de paiement mobile ou encore les cartographies participatives autochtones. Ces pratiques permettent de repenser le numérique à partir des besoins situés et d’inscrire la technologie dans une logique d’autonomie, de justice sociale et de créativité populaire. Les communications pourront aborder ces initiatives comme des alternatives crédibles au modèle dominant d’innovation capitalistique et énergivore.
4. Activismes et résistances numériques
Les technologies numériques sont aussi utilisées comme instruments de résistance et de mobilisation politique. Cet axe s’intéresse aux pratiques d’activisme numérique qui mobilisent les réseaux sociaux pour contester les pouvoirs établis, revendiquer des droits ou construire de nouvelles formes de subjectivité collective. Il met également en lumière les stratégies de détournement ou d’infra-politique qui permettent à des groupes marginalisés d’utiliser le numérique comme espace de communication autonome, hors des logiques dominantes. Les contributions pourront analyser ces expériences comme des formes d’appropriation du numérique, productrices de contre-discours et de nouvelles pratiques de gouvernance citoyenne.
5. Cultures, savoirs endogènes et anthropologie de l’IA : pouvoirs, résistances et imaginaires
Cet axe propose d’interroger les usages de l’intelligence artificielle et des technologies numériques dans les domaines de la culture, des pratiques anthropologiques et des savoirs endogènes. Il s’agit de comprendre comment l’IA reconfigure la production culturelle, les dynamiques sociales et les formes de connaissance locales, tout en suscitant des résistances et de nouveaux imaginaires. Sur le plan culturel, l’IA transforme les modes de création et de diffusion des oeuvres, tout en soulevant le risque d’une homogénéisation des imaginaires, comme l’ont montré Lev Manovich (2001) dans ses travaux sur la culture numérique et Shoshana Zuboff (2019) sur l’économie de la surveillance.
Dans une perspective anthropologique, il convient d’examiner comment les communautés locales s’approprient, détournent ou résistent aux usages imposés des technologies, rejoignant ainsi les approches de Clifford Geertz (1973) sur l’interprétation des cultures et de Tim Ingold (2011) sur l’anthropologie du vivant. Les innovations liées à l’IA rencontrent également les savoirs endogènes. Achille Mbembe (2020) et Souleymane Bachir Diagne (2011) insistent sur l’importance de penser des hybridations entre techniques contemporaines et pratiques traditionnelles (santé, agriculture, artisanat, rituels), ouvrant la voie à une réflexion sur des épistémologies africaines et situées.
Cet axe se veut aussi critique. Dominique Cardon (2015), Cathy O’Neil (2016) et Ruha Benjamin (2019) ont montré combien les algorithmes peuvent reproduire des biais, renforcer les inégalités et alimenter la surveillance. Pourtant, ces mêmes outils peuvent aussi servir à imaginer des alternatives éthiques, inclusives et locales.
Enfin, l’IA engage des prospectives et des imaginaires. Donna Haraway (1991) et Yuk Hui (2016) nous invitent à penser des futurs technologiques pluriels, non réductibles à une vision occidentalo-centrée, mais ouverts aux récits endogènes et aux mythologies locales. Ainsi, cet axe propose de croiser les regards sur l’IA à partir des cultures, savoirs endogènes et pratiques anthropologiques, afin d’en révéler les pouvoirs, les résistances et les horizons d’innovation.
Modalités de soumission
Les propositions de communication d’environ 3000 signes, hors bibliographie, devront être soumises au plus tard le 30 décembre 2025. Elles doivent préciser l’axe thématique choisi, le cadre disciplinaire et théorique mobilisé, les questions de recherche, la méthodologie et, le cas échéant, les terrains étudiés.Chaque soumission devra également comporter les éléments suivants : nom et prénom de l’auteur, adresse électronique, statut académique ou professionnel, affiliation institutionnelle, une notice biographique d’environ cinq lignes, le titre de la communication ainsi qu’une liste de mots-clés.
Calendrier
- 30 décembre 2025 : date limite d’envoi des propositions sur : https://iatnpri.sciencesconf.org
- 20 janvier 2026 : date de notification de la décision aux auteurs
Informations pratiques
Le colloque est prévu le 20, 21 et 22 mai 2026 à Bordeaux
Une publication collective de textes issus des discussions lors du colloque est prévue.
L’inscription au colloque se fera à partir du 1er février 2026 sur https://iatnpri.sciencesconf.orgDes frais de participation sont prévus en fonction de votre statut, de votre provenance et de la modalité de votre participation
Contact
Etienne Damome - etienne.damome@u-bordeaux-montaigne.fr
Comité scientifique
- Agbobli Christian, Université du Québec à Montréal, Canada
- Akam Noble, Université Bordeaux Montaigne, France
- Amador Bautista Rocío, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico
- Anaté Kouméalo, Université de Lomé, Togo
- Bogui Jean-Jacques, Université Houphouët Boigny de Cocody, Côte d’Ivoire
- Cabedoche Bertrand, Université de Grenoble, France
- Cyrulnik Natacha, Université Aix-Marseille, France
- Darmawan Deni, University Pankasira, Indonesia
- Deneuville Allan, Université Bordeaux Montaigne, France
- Ekambo Jean Chrétien, Université de Kinshasa, RDC
- Faisal Bakti Andi, Universitas Pancasila Jakarta, Indonesia
- Gardère Elizabeth, Université de Bordeaux, France
- Halimi Suzy, Université Paris Sorbone Nouvelle, France
- Herra Agilar Miriam, Universidad Autónoma de Querétaro, Mexique
- Kazadi Dikanga Jean Marie, Université de Lubumbashi, République Démocratique du Congo
- Kemly Camacho, Université de San José, Costa Rica
- Kiriya Ilia, Université de Grenoble, France
- Kiyindou Alain, Université Bordeaux Montaigne, France
- Laborde Aurélie, Université Bordeaux Montaigne, France
- Lakel Amar, Université Bordeaux Montaigne, France
- Lehmans Anne, Université de Bordeaux, France
- Lenoble-Bart Annie, Université Bordeaux Montaigne, France
- Liquète Vincent, Université de Bordeaux, France
- Manuel Alexandro Gerrerro, Universidad Iberoamericana, Mexique
- Moustapha Widad, Université de Lille, France
- Naji Jamal Eddine, Université de Rabat, Maroc
- Ndiaye Marième Pollèle, Université Gaston Berger, Sénégal
- Nsude Ifeyinwa, Ebonyi State University, Nigeria
- Pascal Catherine, Université Bordeaux Montaigne, France
- Pate Umaru, Université de Maiduguri, Nigéria
- Perez Da Silva Babo Isabel Maria, Université Lusophone de Porto, Portugal
- Pinède Nathalie, Université Bordeaux Montaigne, France
- Regad Halima, Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem, Algérie
- Rico de Sotelo Carmen, Université du Québec à Montréal, Canada
- Rodriguez Wanguemert Carmen, Université de la Laguna, Espagne
- Rouissi Soufiane, Université Bordeaux Montaigne, France
- Salles Chloë, Université de Grenoble, France
- Sonhaye Sabin, Université de Lomé, Togo
- Tchehouali Destiny, Université du Québec à Montréal, Canada
- Turki Ramzi, Université de Sfax, Tunisie
- Viallon Philippe, Université de Strasbourg, France
- Yao Baglo Namoin, Université de Lomé, Togo
Comité d’organisation
- Abdoul Diop Saidou
- Aidoudi Lamia
- Baldé Mountaga Mamadou
- Capo Chichi Gilbert
- Damome Etienne
- Diallo Fatoumata
- Dok-Kwadda Eric
- Fagade Carole
- Guinez BadillaNatalia
- Kaninda Tshitwala Lynda
- Koffi Atta Mensah
- Lowento Ken
- Mourroux Mélissa
- Moukala Nguimbi Franck Gordan
- Nganga Ida
- Noukafou Augustin
- Nzi Jérémie
- Sossou Etienne
- Tégami Amyn
- Témadji Rémi
- Todo Alipui Joël