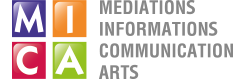Date/heure
02/06/2025
Catégories
Intelligence artificielle et innovation sociale : pour une agentivité réflexive des acteurs en éducation et formation
Enjeux et défis
Numéro spécial [n°19/ vol.1 2026] de la revue, Communication, technologies et développement
Précédée de plusieurs décennies de déploiement, l'intelligence artificielle se révèle aujourd’hui comme un secteur très complexe, avec un développement rapide, encadré par des définitions très variées, des interprétations multiples, des applications diverses dans différents contextes (Unesco, 2019 ; DNE-TN2, 2024). Elle a une portée large, réelle et virtuelle y compris dans sa dimension philosophique (Lévy, 1997). L’IA est en même temps un champ technoscientifique, social et culturel, d’intérêt inter, multi et transdisciplinaire.
En ce qui concerne le contexte de l’éducation, l'Intelligence Artificielle y a fait son entrée depuis longtemps, que ce soit celle qui est basée sur l’informatique « classique » (IA symbolique) ou celle qui, par opposition, repose sur une approche statistique (IA connexionniste) (Bruyen & Fialaire, 2024). En revanche lorsque la société OpenAI a lancé le ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) en novembre 2022, résultat du grand développement des systèmes d’IA générative des dernières années, nous traversons un bouleversement dans la conception du processus d’enseignement-apprentissage et dans celui de ses pratiques. Ce lancement « a provoqué dans le monde entier une prise de conscience du potentiel de l’IA générative » (Bruyen & Fialaire, 2024, p. 3) et a été suivi d’autres Grands Modèles de Langage ou Large Language Models (LLM) pouvant générer du contenu écrit, des images de tout type, des vidéos, des graphiques, des analyses et mêmes des programmes informatiques.
Ainsi, dans le contexte éducatif, l'Intelligence Artificielle, comme toutes les innovations technologiques précédentes (Flichy 2001), se révèle associée à de grands avantages assortis d’inconvénients sérieux, tous les deux démontrables. L’IA suscite des espoirs, des craintes et des défis ; son utilisation « soulève également un certain nombre de questions éthiques » (Miao, 2023, p. 10 ; DNE-TN2, 2024).
Objectif
Dans ce cadre, l’objectif du numéro 19 de la revue COMTECDEV est d’envisager spécifiquement l'intelligence Artificielle en éducation afin de percevoir ses usages, ses défis en ajustements et ses enjeux. Ceci s’inscrit dans les objectifs de la Chaire UNESCO Bordeaux-Montaigne, Pratiques émergentes des technologies et communication pour le développement.
Trois dimensions pourraient être explorées : L’Intelligence artificielle dans sa dimension épistémique en tant que langage intelligible (Bachimont, Verlaet, 2024), dans sa dimension expérientielle en pratiques littéraciques et informationnelles : documentation, littératies (Capelle, Le Deuff, Lehmans, Soumagnac, 2019), et, in fine, dans sa dimension spécifique en dispositifs génératifs (subis ou co-construits) : par exemple, automatisation des données (Mélançon et Pinède, 2023 ; Verdi, 2024), tutorats ou apprentissages adaptés par transactions coopératives en écritures (Bouchardon et Bachimont 2008), sans occulter les approches critiques et éthiques renouvelées (Zacklad, Fossali, 2023).
Il s’agirait donc d’appréhender les relations entre technologies, cultures, économies et politiques afin de percevoir si l’Intelligence artificielle favorise, dans le contexte éducatif, l’innovation technologique et sociale afin d’investir les défis sociétaux contemporains. Cela en accord avec la possibilité de « garantir une utilisation sûre, éthique et efficace des technologies, fondée sur les droits de l’Homme, dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie » (UNESCO, 2021).
Pour appréhender ces phénomènes, une pluridisciplinarité d’approches est sollicitée afin d’assurer des ancrages théoriques et pragmatiques en terrains géo-politiques et culturels diversifiés (langues, pays, cursus, niveaux socio-politiques et socio-économiques). Ceci permettrait une investigation scientifique et une appropriation éthique sous formes de mise en « fabriques », de mise en situations particulières. Les limites d’une dimension uniquement techno-centrée sur les usagers en réponse à un modèle algorithmique ou à une élaboration de plateformes pourraient être ainsi saisies.
Axes
Les propositions pourront s’inscrire dans les axes suivants :
- Impact de l'IA sur les politiques éducatives et les territoires
- IA et développement professionnel des enseignants
- Pédagogie assistée par l'IA : personnalisation de l'apprentissage, outils d'évaluation intelligents, tutorat virtuel et approche non déterministe à préserver
- Les usages sociaux de l’IA dans les contextes éducatifs
- Éthique de l'IA dans l'éducation : la question de la responsabilité entre utopie et dystopie avec impacts des cultures et des politiques publiques
Cet appel est ouvert aux chercheurs et doctorants du monde entier. Les formats acceptés sont : étude de cas, revue de littératures, articles de recherche empirique, essais théoriques et propositions de politiques publiques.
Consignes de rédaction des propositions
Un résumé étendu de 4000 signes, avec une mise en page de quatre pages maximum selon l’ordre suivant : première page : titre, auteurs, emails, thème du texte ; les autres pages : résumé étendu et références documentaires.
Les propositions sous forme de résumés construits devront intégrer les dimensions au choix : d’« innovation sociale », « éducation », « pédagogie » « éthique », « territoires (pays, cultures) » et « citoyenneté ».
Elles devront indiquer l’axe ou les axes de rattachement. Elles seront rédigées en français anglais ou espagnol, et devront comporter la question, le positionnement théorique, méthodologique (corpus ou terrain investi) et une bibliographie indicative selon la norme APA7. Il faudra également indiquer la nature du texte (étude de cas, revue de littératures, article de recherche empirique, essai théorique, propositions de politiques publiques).
Les propositions doivent être adressées par mail aux deux adresses suivantes : catherine.pascal@u-bordeaux-montaigne.fr & miriam.herrera@uaq.mx
Calendrier
- Date de lancement de l'appel : avril 2025
- Date limite envoi des résumés étendus : 2 juin 2025
- Notification d’acceptation : 30 juin 2025
- Date limite de réception des propositions définitives : 15 septembre 2025
- Notification des évaluations des propositions définitives : 2 novembre 2025
- Retour des textes définitifs : 5 janvier 2026
- Date potentielle de parution du numéro : mars-avril 2026.