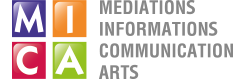Date/heure
06/05/2025
Catégories
Fans et fandoms en transition(s)
Journée d'étude
organisé par le GER Fans, labellisé par la SFSIC
Le GER Fans, labellisé par la SFSIC, organise sa deuxième Journée d’Études le 17 juin 2025, en distanciel uniquement. Cet événement est une pré-conférence au XXIVème Congrès de la SFSIC, prévu à Rennes du 18 au 20 juin, sur le thème « Transition(s) ».
Argumentaire
Parce qu’ils reposent, par exemple, sur la diffusion de programmes télévisés – au renouvellement toujours incertain – ou encore sur l’admiration de célébrités – dont l’image peut se retrouver soudainement ternie par des révélations sur leurs idées ou leurs actes passés, les fandoms, c’est-à-dire les communautés de fans et leurs pratiques, sont par essence des collectifs en évolution et aux frontières mouvantes : ils naissent, disparaissent, réapparaissent et surtout connaissent en permanence des dynamiques internes complexes ; c’est ce que soulignent notamment les récents travaux qui se sont penchés sur leurs facettes les plus sombres, des comportements qualifiés de « toxiques » de certains fans (Reinhard, 2021 ; Stanfill, 2024) aux différentes formes de discriminations qu’ils abritent en leur sein (Pande, 2018).
La présente journée d’étude, organisée par le GER Fans, voudrait justement offrir un espace pour documenter et analyser ces transitions traversées par les fans et leurs fandoms, en mettant en lumière tant les conditions qui les rendent possibles que leurs conséquences. Les évolutions des attitudes et des pratiques chez les fans sont en effet à envisager au contact ou à l’intérieur de transformations plus larges : mutations des écosystèmes médiatiques ou technologiques, renouvelant les sources des fandoms et leurs modes d’expression, émergence de certaines problématiques sociales dont vont se saisir les fans au travers de leur objet de passion, etc. En miroir, c’est le statut et l’image des communautés fans qui peuvent s’en trouver modifiées, eux qui, comme les « geeks », ne subissent par exemple plus la même stigmatisation depuis le tournant des années 2000 (Peyron, 2013 ; Bourdaa, 2021). Pour traiter plus précisément de toutes ces transitions, nous sollicitons toute proposition de communication qui pourra s’inscrire dans un ou plusieurs des quatre axes suivants, ces derniers ne prétendant pas à l’exhaustivité :
1. Fandoms en contextes numériques, une transition sans fin ?
Pour les fans et autres amateurs, l'arrivée de la culture numérique a constitué une phase de transition et une aubaine d’une ampleur inégalée. Il ne s’agit pas simplement d’un changement d’échelle et de moyens de communication : la structure même des communautés et des formats pour exprimer leurs attachements ont évolué. Ce processus a été étudié dans de nombreux domaines. Qu’il s’agisse des loisirs avec, par exemple, les passionnées de tricot qui voient leur pratique transformée par l’accessibilité des techniques et des modèles (Zabban, 2015), ou encore des fans de Star Wars qui documentent l’univers de la saga sur leur propre Wiki, Wookiepédia (Berthou, 2011), les passions sont transformées et amplifiées par le numérique. Étudier ces transitions, ces passages et comparer les pratiques de fans entre elles (Booth, 2010), avec celles du grand public (Combes, 2015) ainsi que la circulation massive des informations avant et après internet (Pinker, 2020) par exemple, peuvent nous apprendre beaucoup sur le paysage médiatique contemporain.
De plus, à un niveau plus micro, il est possible d’étudier les transitions au sein même des dispositifs numériques. La disparition, l’obsolescence ou le changement structurel de plateformes, peuvent pousser les passionnés à les quitter alors qu’un fort investissement y a avait été construit (voir avec l’exemple de Tumblr, Morimoto & Stein 2018). Etudier comment le « capitalisme de plateforme » (Srnicek, 2018) contraint l’expression des fans mais aussi comment ces communautés s’insèrent dans les interstices des affordances numériques en perpétuelle évolution est là aussi un riche sujet de recherches possibles.
Enfin, la transition numérique est aussi une transition méthodologique, qui offre aux chercheuses et aux chercheurs un accès plus grand aux contenus créés par les fans, mais laisse dans le même temps de nombreux points aveugles. De multiples questions, encore loin d’être pleinement consensuelles dans le monde académique, restent en suspens, notamment autour de la question des fans non visibles (Falgas, 2016) de l’éthique de la recherche en ligne (Barats, 2017) et du respect de la vie privée.
2. Brouiller les catégories de genre et de sexualités : le « trans turn » des fan studies ?
De longue date, les fans ont été étudiés au prisme des questions de genre (gender). Les travaux pionniers pour la discipline (Bacon-Smith, 1992 ; Jenkins, 1992) analysaient par exemple déjà comment les femmes fans de Star Trek parvenaient, à travers leurs communautés et leurs pratiques créatives telles que la fanfiction slash1, à bousculer l’hétéronorme en explorant la sexualité masculine gay. Les fandoms sont ainsi à appréhender comme des espaces de résistance, de transgression, où il est permis de questionner les normes de genre, de sexualités, et de construire son identité par-delà les binarismes.
Si les fan studies se sont longtemps focalisées sur les femmes cisgenres, blanches et issues de la classe moyenne, divers travaux ont mis en lumière la présence croissante au sein des communautés de personnes qui se déclarent transgenres, non-binaires, genderfluid, queer… Jennifer Duggan identifie ainsi un « tournant trans » (trans turn), dans le champ académique, un « moment où les études trans et l’étude des fanfictions sont entrées en contact de manière explicite et délibérée » (Duggan, 2023). De fait, les fanfictions multiplient les représentations de personnages « queerisés », par exemple à travers le trope du « genderfuck » - une catégorie de récits où un personnage fictionnel change de sexe (Busse et Lothian, 2009). La pratique du genderbend cosplay met pour sa part l’accent sur la performance de genre et sur l’agentivité des fans qui s’y adonnent (Gackstetter Nichols, 2019).
Il a en outre été démontré que l’investissement dans un fandom pouvait jouer un rôle de révélateur ou d’accélérateur dans la découverte de leur propre identité LGBTQ+ par des jeunes gens (McInroy et Craig, 2018). Une fois cette étape du coming in franchie, certaines communautés fonctionnent comme des safe spaces, des espaces sécurisants où les personnes concernées peuvent revendiquer leur transidentité ou leur queerness. Enfin, les pratiques d’activisme fan permettent de porter des messages politiques progressistes et de lutter contre les discriminations subies par celles et ceux qui sortent du cadre cis-hétéro.
Les communications proposées pourront développer de nouveaux terrains où les pratiques de fans instillent un « trouble dans le genre » (Butler, 2006). Les contributeur·ices sont particulièrement invité·es à adopter des approches intersectionnelles et/ou transnationales, encore trop peu mobilisées par les travaux en fan studies qui prennent en charge des problématiques liées au genre, au queer et aux transidentités (Duggan, 2023).
3. Les fans par-delà les frontières et les cultures
Dans les communautés de fans, les transitions en jeu peuvent également être liées aux frontières physiques et culturelles. La localisation géographique des fans a un impact sur les expériences auxquelles ils ont accès (Escurignan, 2021), que l’on parle d’accès à des conventions, à des rencontres entre fans ou à des produits dérivés. Les fans traversent régulièrement des frontières pour accéder à des événements ou à des expériences (du San Diego Comic Con au Warner Bros Studio Tour de Londres, en passant par les parcs Disney), et se confrontent ainsi à d’autres cultures au sein de leurs fandoms. Les communautés de fans en ligne peuvent aussi être internationales, voire transnationales (Straubhaar, 2007; Esser, Bernal-Merino & Smith, 2016), effaçant autant que possible l’idée de frontière entre ses membres. Nonobstant, que ce soit in situ ou en ligne, les frontières existent bien, et on l’observe aussi bien dans les nationalités représentées aux événements physiques (qui peut accéder à ces événements, tant d’un point de vue économique que politique ?) que dans celles présentes sur les réseaux socio-numériques. On voit en outre des phénomènes de globalisation (Appadurai, 1996; Attique, 2011), de localisation (Esser, 2002; Esser, Bernal-Merino & Smith, 2016) et de « glocalisation » (Iwabuchi, 2002; Sinclair and Wilken, 2009) : les communautés de fans internationales/transnationales coexistent avec des communautés régionales, nationales ou locales, créées en fonction de la localisation géographique de leurs membres ou de la langue parlée. On le voit tout autant pour les fans de produits médiatiques comme Star Wars que pour les fans de musique, de Taylor Swift à la K-pop. Enfin, il est intéressant de noter que les fans sont liés, par-delà leurs origines et leurs cultures, par leur objet d’admiration. Leur fandom est ce qui leur permet d’aller au-delà de leur culture individuelle pour « faire culture » tous ensemble (visibles au regard de la création d’une terminologie propre à la communauté, de pratiques spécifiques, etc.). La manière dont le fandom et les communautés de fans permettent d’aller au-delà de frontières géographiques et culturelles revêt ainsi de nombreux aspects, qu’ils soient géographiques, politiques, mercantiles ou communicationnels. On l’a notamment vu ces derniers mois avec l’aspect éminemment international des concerts de Taylor Swift à Paris, ou avec la communion, par-delà les frontières, des fans de One Direction suite au décès de Liam Payne. Il est donc plus qu’important d’étudier ces phénomènes.
Ainsi, cet axe a pour but de mettre en lumière les recherches qui jouent avec ces notions d’international, de transnational, de global, de local, de glocal, de transculturel et d’interculturel dans le cadre des études de fans. Cela inclut les objets de recherches eux-mêmes, mais également les méthodologies de recherche utilisées (Beck, 2005), qui peuvent être elles aussi internationales, locales, transnationales, centrées sur une ou plusieurs cultures, langues, et communautés. Les fans sont dans des mouvements permanents de transitions culturelles, géographiques et politiques, qu’il est nécessaire d’analyser pour mieux comprendre leurs pratiques et l’organisation de leurs communautés.
4. Évolutions des carrières de fans et “migrations” entre fandoms
Les questions de transition dans les communautés de fans peuvent également se matérialiser dans les évolutions de carrières des fans et dans les mouvements de fans d’une communauté vers une autre. En effet, certains fans, et en particulier les fans lesbiennes (Bourdaa, 2021), se déplacent d’une série à une autre, et donc d’un fandom à un autre au gré des représentations homosexuelles dans les séries. Le genre télévisuel, qui peut être un des marqueurs des fans appartenant à une communauté ou plusieurs communautés (les fans de science-fiction, d’horreur, etc.) importe peu à ces fans qui sont en quête de personnages lesbiens auxquels s’identifier et en quête de représentations positives. Elles cherchent également à se retrouver entre elles, demandant à toute la communauté de se suivre d’un fandom à un autre. La circulation des contenus (fanfictions, fan arts, gifs, vidéos) est fondamentale dans ce phénomène puisque c’est souvent à travers les partages sur les différents réseaux sociaux (Twitter et Tumblr en tête) que les fans découvrent les nouvelles représentations à suivre. La connaissance se construit alors de façon collaborative et se partage dans les communautés, pour finalement n’en former qu’une, celle des fans lesbiennes. Avec la convention ClexaCon, les fans migrent littéralement le temps de deux week-end par an (un à Las Vegas et un à Londres) pour se retrouver dans un espace physique réel et passer donc d’une migration virtuelle à une migration réelle.
Ce cas d’école invite à regarder de près les trajectoires et les carrières de fans qui peuvent intégrer ou quitter des fandoms pour de multiples raisons. L’orientation sexuelle, l’âge, le bord politique, etc. d’un côté, la disparition ou la réapparition de l’objet de passion (Williams, 2015) ou encore l’évolution de sa perception sociale – pensons au cas de J. K. Rowling – de l’autre, sont autant de variables à prendre en compte pour comprendre comment on peut “être fan” à l’heure actuelle. Une autre question sur les carrières de fans et leurs évolutions pourra alors être celle des phénomènes de transmission. Comment se transmet l’intérêt pour une oeuvre ou des oeuvres culturelles? Comment les fans découvrent-ils les oeuvres puis les communautés? Comment cela impacte-il leur posture de fan ?
Les propositions pour des communications de 30 minutes, en français ou en anglais, sont à faire parvenir avant le 6 mai 2025 sous la forme d’un résumé de 500 mots maximum et d’une courte notice bio-bibliographique (100 mots) aux personnes suivantes : Hélène Breda - helene.breda[a]univ-paris 13.fr, Justine Breton - justine.breton[a]univ-lorraine.fr et David Peyron - david.peyron[a]univ-amu.fr
Calendrier
- 6 mai 2025 : Date limite de soumission des propositions
- 16 mai : retour aux auteur·ices
- 17 juin : Journée d’études en ligne
Comité organisateur - Membres porteurs du GER Fans :
- Mélanie Bourdaa, Professeure des universités en Sciences de l’Information et de la communication, Université Bordeaux Montaigne, chercheuse titulaire au laboratoire Médiations, Informations, Communications, Arts (MICA)
- Hélène Breda, Maîtresse de conférences en Sciences de l’Information et de la communication, Université Sorbonne Paris Nord, chercheuse titulaire au Laboratoire des Sciences de l’Information et la Communication (LabSIC) et associée à l’Institut de Recherche sur le Cinéma et l’Audiovisuel (IRCAV, Université Sorbonne Nouvelle)
- Justine Breton, Maîtresse des conférences en Littérature comparée (Etudes culturelles) à l’Université de Lorraine, site de Nancy, chercheuse titulaire au laboratoire Sciences de l'Antiquité et du Moyen Âge (SAMA)
- Julie Escurignan, enseignante-chercheuse (équivalent Maîtresse de Conférences) en Management et en Sciences de l’Information et de la communication, Université Catholique de l’Ouest, (UCO Angers), chercheuse titulaire au Centre Humanités et Sociétés (CHUS) et associée au MICA (Université Bordeaux Montaigne)
- Sébastien François, enseignant-chercheur (équivalent Maître de Conférences) en Sciences de l’Information et de la communication, Université Catholique de l’Ouest, campus de Nantes (UCO Nantes), chercheur titulaire au Centre Humanités et Sociétés (CHUS) à l’UCO
- David Peyron, Maître de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication, Université Aix-Marseille, IUT Aix-Marseille, site d’Arles, chercheur titulaire à l’Institut Méditerranéen des Sciences de l’Information et de la Communication (IMSIC) et associé à Institut de Recherche Médias, Cultures, Communication et Numérique (Irméccen, Université Sorbonne Nouvelle)
1 Récits mettant en scène des histoires romantiques et/ou érotiques entre personnages masculins.