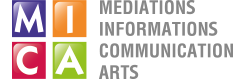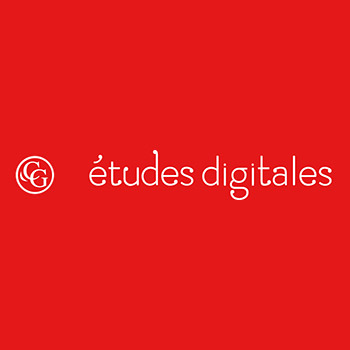Date/heure
15/04/2025
Catégories
Anthropologie des techniques et ordre symbolique : une narration « franchisée »
Appel à contribution de la revue Études digitales
Direction du numéro : Katrin Becker (Faculté des Sciences Humaines, des Sciences de l’Éducation et des Sciences Sociales, Université du Luxembourg)
La revue Études digitales défend une approche herméneutique, critique, rhétorique et poétique des technologies. Elle se veut résolument transdisciplinaire. Elle est édité par Classiques GARNIER. ISSN : 2496-7858
- Direction de la publication : Franck Cormerais, Jacques Athanase Gilbert, Daphnée Vignon, Armen Khatchatourov
- Direction du numéro : Katrin Becker (Faculté des Sciences Humaines, des Sciences de l’Éducation et des Sciences Sociales, Université du Luxembourg)
- Téléchargez l'appel à article
Les techniques sont intrinsèquement liées à l'activité humaine, influençant et transformant notre rapport au monde et à nous même. En tant qu’objets et processus façonnés par et pour l’agir humain, elles servent à de nombreuses finalités matérielles et conceptuelles. A l'interface entre l’homme et sa représentation du monde, les techniques jouent certes un rôle fonctionnel mais aussi fictionnel dans la mesure où, devenant des outils de pouvoir, de par leur influence sur l’interprétation du monde et sa transformation, elles se trouvent également en mesure d’en remodeler l’imaginaire.
Or, à l'ère de la cybernétique, de la captation massive de données, de l’Intelligence artificielle et du gouvernement algorithmique, les techniques cherchent à dépasser leur statut d’outils pour devenir des agents capables de former un ordre symbolique technicisé lequel se donne, par ses nombreux récits et représentations, comme un nouvel univers « institué » (Musso, 2017) avec son pouvoir de référence. Cette tendance est particulièrement manifeste dans le développement des industries du numérique et dans le phénomène de « franchise » qui désormais désigne indifféremment toute activité économique, créative, voire « fictionnelle ».
Cette évolution soulève des questions cruciales concernant les notions de subjectivité et d’objectivité, mais aussi les systèmes politiques, juridiques, économiques et sociaux impactés. En explorant la dynamique entre technique et symbolique, ce numéro de la revue Études digitales porte sur la place et l’évolution de la technique dans le domaine des récits et des sciences humaines, et la transformation des interactions entre l’homme et le monde qu’elle provoque. Il s’inscrit dans la continuité d’une série de travaux publiés par la revue pour une compréhension approfondie de la manière dont les technologies digitales redéfinissent les relations de pouvoir et les interactions humaines mais aussi les structures de notre imaginaire. Il permettra d’envisager des scenarii en ces temps d’incertitude. Il devrait également offrir des perspectives critiques sur les enjeux éthiques et philosophiques liés à l'innovation technique et contribuer ainsi à une réflexion plus globale sur l'avenir des sociétés technicisées.
Cette publication entend développer une perspective interdisciplinaire sur la nature et l'impact des nouvelles technologies. Les propositions d'article pourront s’inscrire dans l’un des axes suivants, qui ne sont pas limitatifs :
- Anthropologie du droit numérique : Étude du conflit entre une justice de la parole et une justice du programme. Ce conflit révèle la transformation du médium de l’écriture par le numérique, qui doit être envisagée comme la dernière étape de l’histoire de l’écriture,
- Conflit des « modes d’existence » en régime numérique. Façonnage d’hypothèses ou de scénarios de vie, à travers par exemple des œuvres de fiction et de science-fiction, mais également analyse de secteurs d’activité mobilisant de longue date les techniques et technologies. Modes d’existence, ontologies des techniques, mises en récits, imaginaires, esthétique
- Sémiologie et épistémologie des signes : Analyse des transformations et des variations affectant la nature des signes en régime numérique. Prise en compte de la dimension de literacy, entre manipulation formelle de marques graphiques et construction sociale du sens,
- Éthique de l'innovation et praxéologie. Analyse des présupposés
Combinant des méthodes qualitatives et quantitatives pour analyser les interactions complexes entre technique et société, ce numéro d’Études digitales pourra faire appel à différentes approches :
- Revue de littérature : analyse de travaux existants dans les domaines de l'anthropologie des techniques et technologies,
- Études de cas : investigation approfondie de cas spécifiques permettant d’analyser les dynamiques anthropologiques en jeu entre technique et pouvoir.
- Entretiens et enquêtes : recueil des perceptions et des expériences des acteurs concernés par les nouvelles technologies.
- Analyse des discours : étude des représentations et des narrations entourant les technologies et leur impact sur les systèmes symboliques et sociaux.
- Proposition herméneutique ou heuristique qui permettra de faire émerger une question nouvelle et de contribuer à une évolution des cadres paradigmatiques
En résumé, ce numéro d’Études Digitales ambitionne de jeter un éclairage novateur sur les dynamiques entre technique, société, et leurs représentations réciproques en mettant l'accent sur les transformations symboliques, épistémologiques, narratives, ontologiques et éthiques. En adoptant une approche interdisciplinaire, il vise à enrichir notre compréhension des technologies émergentes et de leur impact sur le monde humain.
Calendrier & Consignes
- 15 avril 2025. Date limite d'envoi des propositions d’articles à etudes.digitales.soumissions@gmx.fr, en spécifiant le nom de l’appel dans l’objet du mail, sous la forme d'un résumé de 2000 signes accompagnées d’une courte notice biographique. L'acceptation du résumé ne présume pas de l'acceptation de l'article définitif, soumis à une relecture en double aveugle.
- 30 avril 2025. Avis du comité éditorial
- 30 Juin 2025. Envoi des textes complets pour une évaluation en double aveugle. Ils seront accompagnés d’un résumé en français et en anglais inférieur à 800 signes, espaces compris. Seuls les articles en français sont acceptés.
- Publication fin 2025.
Indications bibliographiques
- Carvais,R, Garçon A-F. et Grelon A. (dir) (2017). Penser la technique autrement, XVIe – XXIe siècle, en hommage à l’œuvre d’Hélène Vérin, Paris, Classiques Garnier, 2017.
- Goody, Jack (1977), The Domestication of the Savage Mind, Cambridge, Cambridge University Press.Harman,
- Graham, (2018) Objet-oriented Ontology, A new theory of Everything, Pelican book.
- Herrenschmidt, Clarisse (2007), Les trois écritures ; langue, nombre, code, Paris, Gallimard.
- Hottois, Gilbert (1984), Le Signe et la technique, Paris, Aubier.
- Kapp, Ernst (2007) [1877)], Principe d’une philosophie de la technique, Paris, Vrin.
- Legendre, Pierre (1985), L’inestimable objet de la transmission, Paris, Fayard.
- Legendre, Pierre (1998), La 901ème conclusion. Étude sur le théâtre de la Raison, Fayard, Paris.
- Leroi-Gourhan, André (1964-1965), Le geste et la parole, Paris, Albin Michel.
- Mauss, Marcel (1950) [1937], “Les techniques du corps” dans Sociologie et anthropologie, Paris, PUF.
- Musso, Pierre (2017), La religion industrielle, Monastère, manufacture, usine; une généalogie de l’entreprise, Paris, Institut d’Études Avancées de Nantes / Fayard
- Musso, Pierre (dir)(2022), La renaissance industrielle, Paris, Manucius
- Remotti, Francesco (1997), Le antropologie degli altri. Saggi di etnoantropologia, Torino, Scriptorium.
- Rosengren, Mats (2019), L'art des cavernes : perception et connaissance, Hermann, 2019.
- Sfez, Lucien (2002), Technique et idéologie. Un enjeu de pouvoir. Paris, Le Seuil.
- Sigaut, Francois (2012), Comment Homo devint Faber, Paris, CNRS Éditions.
- Sini, Carlo (2009), L’uomo, la macchina, l’automa, Torino, Bollati Boringhieri.
- Smith, Brian Cantwell (1998) On the Origine of Objects, MIT Press
- Stourdzé, Yves, Pour une poignée d’électrons, pouvoir et communication, Sens&Tonka, Paris, 2016.