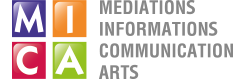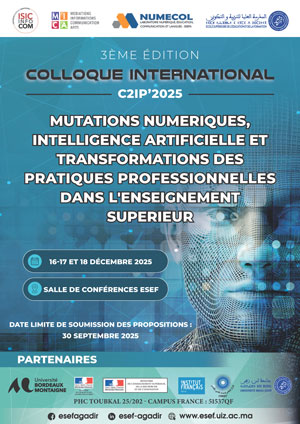Date/heure
30/09/2025
Catégories
Mutations Numérique - C2IP’2025
Intelligence Artificielle et Transformations des pratiques professionnelles dans l'enseignement supérieur
3ème édition du Colloque International C2IP'2025
L’enseignement supérieur se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins, confronté à une vague de transformations d’une ampleur et d’une rapidité inédites. L’essor fulgurant du numérique, impulsé par la pandémie de COVID 19, et l’émergence spectaculaire de l’intelligence artificielle (IA), notamment ses déclinaisons génératives, ne constituent plus une simple évolution technologique, mais une véritable rupture épistémologique et praxéologique. Cette transition pousse chercheurs, praticiens et décideurs à réinterroger les piliers fondamentaux de l’enseignement supérieur (formation, recherche, gouvernance,…) ainsi que les pratiques professionnelles qui les sous-tendent.
Terme « servant surtout à circonscrire de manière floue un champ très vaste » (Baron, 2014), le « Numérique » désigne un large éventail allant des équipements informatiques aux contenus multimédias (Inaudi, 2017). Cette appellation, ou le simple substantif « numérique », est « significative d'un rapprochement systématique entre mise à disposition de matériels et transformation subséquente des pratiques d'enseignement et des apprentissages » (Aillerie, 2017). L’avènement de l’intelligence artificielle, considérée comme un ensemble de techniques permettant aux machines d’exécuter des tâches et de résoudre des problèmes habituellement réservés aux capacités cognitives humaines ou animales (LeCun, 2016), ouvre des perspectives vertigineuses pour la personnalisation des apprentissages et l’automatisation des tâches chronophages.
En revanche, l’intégration exponentielle des avancées numériques s’accompagne de défis cruciaux qui bouleversent les postures pédagogiques, les pratiques professionnelles, les modes de gouvernance universitaire, les rapports au savoir ainsi que les compétences attendues des étudiants. Ces mutations entraînent une reconfiguration des rôles traditionnels de l’enseignant, de l’étudiant et de l’institution universitaire elle-même (Bourgeois, 2023). Loin de toute vision technodéterministe, les réformes éducatives récentes au Maroc, particulièrement la loi-cadre 51-17 ainsi que le PACTE ESRI 2030, placent l’apprenant au cœur du processus d’enseignement-apprentissage, tandis que l’enseignant est appelé à s’approprier la culture numérique et à intégrer l'IA dans ses pratiques professionnelles.
Par ailleurs, les pratiques en recherche scientifique sont également impactées. L’IA ouvre des possibilités émergentes en matière de traitement des données massives, de modélisation de phénomènes complexes et d’automatisation de certaines tâches cognitives, notamment la revue de littérature (Jordan & Mitchell, 2015 ; Min, Chen & Bengio, 2021). À cet égard, elle tend à s’imposer comme un véritable outil heuristique, capable de faciliter la formulation de nouvelles hypothèses et d’orienter la recherche scientifique (Gil & Selman, 2019 ; Holzinger et al., 2017). Toutefois, cette évolution s’accompagne de défis éthiques et méthodologiques majeurs.
La reproductibilité des travaux assistés par IA, la transparence des processus algorithmiques, de même que les risques liés à l’intégrité scientifique, notamment à travers l’usage des générateurs de texte, suscitent de vives préoccupations (Bender et al., 2021 ; Floridi & Cowls, 2019). Face à ces mutations, une redéfinition des cadres déontologiques de la recherche s’impose, en prenant appui sur les principes de responsabilité, d’explicabilité et de traçabilité (OCDE, 2023). Les transformations actuelles des pratiques éducatives et de recherche se fondent sur une assise en retrait mais décisive : la donnée. L’essor des environnements numériques d’apprentissage (ENA), des plateformes de recherche et des outils de gestion administrative engendre une production massive de données relatives aux apprenants, aux enseignants et aux institutions elles-mêmes (Williamson & Piattoeva, 2021 ; Kitchin, 2014). Ces flux d’informations alimentent le développement de nouveaux champs de recherche à savoir les « learning analytics » et les « research analytics », qui visent à éclairer les décisions pédagogiques et scientifiques. Il convient toutefois de souligner que cette évolution exige l’instauration d’une gouvernance des données à la fois rigoureuse et éthique (OECD, 2021). En effet, les questions de sécurité, de souveraineté numérique, de propriété intellectuelle et de respect de la vie privée deviennent indispensables (Daries et al., 2014 ; Floridi, 2013).
Enfin, les dynamiques de transition et de transformation numérique impactent considérablement les pratiques infocommunicationnelles au sein de la sphère universitaire. Au cœur d’un contexte teinté par la propagation massive des informations erronées, des manipulations médiatiques et des deepfakes, l’éducation aux médias et à l’information s’avère incontournable pour l’université, dans le but de renforcer l’esprit critique des futurs citoyens et des chercheurs (Mihailidis & Viotty, 2017 ; Wardle & Derakhshan, 2017). Parallèlement, la communication institutionnelle interne doit s’adapter pour accompagner les mutations organisationnelles, maintenir la cohésion des communautés éducatives et favoriser l’adhésion aux changements induits par le numérique (Joule & Beauvois, 2014). Tandis que sur le plan externe, la diffusion et la valorisation de la recherche scientifique s’étendent via de nouveaux canaux, tels que les réseaux sociaux, les blogs académiques ou les plateformes d’open science, qui permettent un contact plus direct avec les acteurs sociaux. Pourtant, ces modes de communication, s’ils favorisent la visibilité et l’accès aux savoirs, appellent également à s’interroger sur leur validation, leur légitimité scientifique et leur réception dans l’espace public (Pignard-Cheynel, 2017 ; Grand et al., 2012).
C’est pour aborder ces enjeux que l’École Supérieure de l’Éducation et de la Formation d’Agadir (ESEFA) de l’Université Ibnou Zohr, organise un colloque sous le thème :
Mutations Numériques, IA et Transformations des pratiques professionnelles dans l'enseignement supérieur
Ce colloque a pour objectif général d’étudier, dans une perspective pluridisciplinaire et critique, les mutations engendrées par le numérique et l’intelligence artificielle dans l’enseignement supérieur, en mettant l’accent sur les reconfigurations des pratiques professionnelles, tant dans les domaines de la pédagogie, de la recherche, de la gouvernance que de l’infocommunication. Il vise essentiellement à cerner les transformations à l’œuvre, d’en analyser les implications épistémologiques, méthodologiques, organisationnelles et éthiques, et de contribuer à la formulation de pistes d’action et de réflexion en phase avec les défis contemporains de l’université à l’ère du numérique.
Ce colloque vise à :
- Analyser les transformations des pratiques pédagogiques et didactiques induites par le numérique et l’IA dans l’enseignement supérieur.
- Explorer les apports et les limites de l’IA dans la recherche scientifique, notamment en matière de production, de diffusion et de validation des savoirs scientifiques et d’éthique de la recherche.
- Examiner les enjeux liés à la gouvernance des données dans les universités à l’ère du numérique.
- Identifier les mutations des pratiques infocommunicationnelles à l’université et leurs effets sur la communication scientifique et institutionnelle.
Ce colloque constitue une plateforme pour des discussions productives, articulées autour des quatre thématiques suivantes :
Axe 1 : Gouvernance des données
- Structuration d’une politique de gouvernance des données : enjeux de sécurité, de traçabilité et de souveraineté numérique.
- Protection de la vie privée des étudiants, enseignants et chercheurs dans les environnements numériques d’apprentissage (ENA).
- Normes éthiques et cadres réglementaires encadrant la collecte, le traitement et le partage des données académiques.
- Exploitation des learning analytics et research analytics pour éclairer les décisions pédagogiques et scientifiques.
- Gouvernance algorithmique : rôle des universités dans la régulation des systèmes automatisés d’évaluation et de gestion.
- Propriété intellectuelle et productions académiques assistées par IA : quelles adaptations juridiques et institutionnelles ?
Axe 2 : Pratiques infocommunicationnelles
- Transformation de la communication institutionnelle à l’ère du numérique : stratégies d’accompagnement au changement.
- Infocommunication et cohésion universitaire : enjeux de médiation, de circulation de l’information et d’adhésion.
- Éducation aux médias et à l’information (EMI) : développement de l’esprit critique face à la désinformation, aux deepfakes et à la manipulation algorithmique.
- Nouvelles modalités de diffusion et de valorisation des savoirs : réseaux sociaux, blogs scientifiques, plateformes d’open science.
- Validation scientifique, légitimité académique et réception publique dans les nouveaux espaces numériques de communication.
- Évolution des métiers de la communication universitaire : compétences clés dans les environnements numériques complexes.
Axe 3 : Pratiques en recherche
- Automatisation des tâches scientifiques : revue de littérature, traitement de données, rédaction assistée par IA.
- L’IA comme outil heuristique : simulation, modélisation et génération d’hypothèses en contexte de recherche.
- Transparence, explicabilité et reproductibilité des travaux assistés par l’intelligence artificielle.
- Enjeux éthiques : plagiat algorithmique, biais des modèles, respect de l’intégrité scientifique.
- Vers de nouveaux paradigmes méthodologiques : reconfigurations induites par les technologies cognitives.
- Former les chercheurs aux usages critiques et responsables de l’intelligence artificielle.
Axe 4 : Pratiques en éducation
- Reconfiguration des postures pédagogiques : nouveaux rôles de l’enseignant et de l’étudiant à l’ère numérique.
- Intégration de l’IA dans les dispositifs de formation initiale et continue des professionnels de l’éducation.
- Personnalisation des parcours d’apprentissage : systèmes de recommandation, analyse des données éducatives.
- Innovations en didactique des langues : traducteurs automatiques, assistants conversationnels, interfaces interactives.
- Intelligence artificielle et équité éducative : vers des dispositifs inclusifs, adaptatifs et différenciés.
- Hybridation des pratiques pédagogiques : entre présence, distance et immersion (réalité augmentée/virtuelle).
- Compétences numériques et soft skills à développer chez les futurs enseignants et éducateurs.
Comité organisateur
- Khadija YOUSSOUFI, ESEF, Université Ibnou Zohr
- Soufiane ROUISSI, Université Bordeaux Montaigne, France
- Nathalie PINEDE, Université Bordeaux Montaigne, France
- Hicham EL KHALIFI, ESEF, Université Ibnou Zohr
Calendrier
- 8 août : Lancement de l’appel et début des soumissions
- 30 septembre 2025 : Date limite de soumission des propositions
- 20 octobre : Date limite de notification de la décision du comité scientifique
- 10 novembre : Date limite d’envoi des versions révisées
- 1er décembre : Date limite de réception des textes complets
- 16 – 17 et 18 Décembre 2025 : Tenue du colloque
Dans tous les cas, pour déposer votre proposition de communication, veuillez renseigner le formulaire suivant : https://bit.ly/C2ip2025 Si votre texte , notes, bibliographie avec respect de la norme bibliographique APA, de 30000 à 50000 signes espaces compris, est déjà prêt, après avoir rempli le formulaire pensez à envoyer celui-ci par mail à l'adresse c2ip25.esefa@gmail.com (évaluations en double aveugle).
Les frais de participations
- 300,00 DH pour les doctorants (30 euros)
- 800,00 DH pour les enseignants (80 euros)
Langues du colloque : Anglais, Arabe, Français