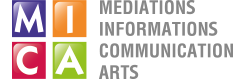Date/heure
03/11/2025
Catégories
Repenser l'animation socioculturelle à l'ère du numérique : inclusion, éducation et engagement
Le Pôle Carrières Sociales ISIAT-IUT Bordeaux-Montaigne, l’UMR CNRS 5319 PASSAGES, l’Université Bordeaux-Montaigne, en partenariat avec l’École Polytechnique de Lisbonne, l’Université de Malaga, le CRAJEP-NA, le CNFPT, Chaire UNESCO ISNoV (Intervention sociale non-violente) et le laboratoire MICA organisent le 42ème colloque international de l’ISIAT qui se déroulera à Bordeaux les lundi 26 et mardi 27 janvier 2026.
Argumentaire
- Téléchargez l'appel à communication dans son intégralité.
L'émergence du numérique transforme profondément les pratiques culturelles, éducatives et sociales de nos sociétés. Dans le champ de l'animation socioculturelle et de l'éducation populaire, ces mutations ne sont ni anecdotiques ni secondaires : elles s'inscrivent dans les modalités de coopération et d'échange au sein des mouvements d'émancipation, d'apprentissage non formel et d'engagement citoyen (Besse L. et al., 2021). L'éducation populaire a toujours su s'approprier les outils de son époque : imprimerie (Go, 2022), radio (Poulain, 2022), vidéo (Ducellier, 2025), théâtre-forum (Sacco, 2024). À ce propos, Hélène Grimbelle (2017) affirme que le numérique, loin d'être un simple support technique, reconfigure aujourd'hui les formes d'action collective, les modes de médiation, les stratégies d'appropriation du savoir et les rapports aux institutions.
Dans différents contextes : les territoires (urbains, ruraux, quartiers prioritaires), les équipements socioculturels (centres sociaux, ludothèques, bibliothèques, tiers-lieux), les associations et les établissements scolaires de nombreux professionnels de l’animation expérimentent déjà des pratiques numériques avec différents objectifs : l'inclusion, la visibilité, la participation ou bien la créativité. Mais ces pratiques restent encore insuffisamment documentées et pensées dans leur globalité ou dans leurs problématiques. Si .le numérique peut être un levier de médiation et d'inclusion (Deydier, 2019), il peut aussi reproduire, voire aggraver, certaines inégalités sociales, culturelles et territoriales. Il interroge ainsi directement les valeurs fondatrices de l'animation socioculturelle : accès à l'autonomie, à la parole, à la culture et au pouvoir d'agir (Fretin, J.).
À l'heure des plateformes, de l'intelligence artificielle, des politiques publiques de « transformation numérique », mais aussi de la montée des logiques de contrôle, de captation des données et de dépendance aux infrastructures privées, il devient urgent d'interroger les usages numériques dans l'animation socioculturelle sous un angle éthique, politique, culturel, mais aussi économique, éducatif et symbolique. Qui conçoit les outils numériques pour le monde associatif ou éducatif aujourd'hui, et selon quelles logiques ? Le numérique est-il un levier de transformation sociale ou un vecteur de dépendance ? Quels savoirs sont mobilisés, quels savoir-faire sont invisibilisés, et quels apprentissages sont rendus possibles ou, au contraire, empêchés ?
Les représentations du monde et les imaginaires numériques que ces outils véhiculent méritent aussi d'être questionnés (Carton, 2019). Sont-ils mobilisés de manière critique et/ou réappropriés collectivement ? Le numérique peut-il encore être un espace d'expérimentation, de résistance ou d'émancipation, dans un contexte marqué par la standardisation du numérique?
Les conditions dans lesquelles on peut faire émerger une culture numérique partagée, libre, inclusive, voire subversive, doivent être re-définies (Vacaflor et al., 2020). Mais comment les professionnels de l'animation peuvent-ils se positionner face à ce langage numérique à la fois commun et disputé ? Voilà la question principale de ce colloque. Les dispositifs qui existent aujourd’hui peuvent encourager une approche critique et créative du numérique dans les pratiques éducatives et sociales.
Ces journées visent à créer un espace de réflexion, d'échange et de valorisation de pratiques innovantes et critiques, à la croisée de plusieurs mondes : celui de l'intervention sociale, de l'éducation populaire, de la recherche universitaire, de la médiation culturelle et de l'action citoyenne et l'animation sociale. Ces journées proposeront un équilibre entre communications académiques, retours d'expériences de terrain, ateliers participatifs et présentations de projets. Une attention particulière sera portée à la pluralité des formats, à la dimension expérientielle et accessible des échanges, ainsi qu'à l'accueil de contributions issues de collectifs hybrides, de structures locales et internationales ou de démarches collaboratives.
Axe 1 – Inégalités numériques et inclusion
Cet axe interroge les inégalités d'accès, d'usages et de compétences numériques dans une société où le numérique est devenu un pilier incontournable de l'information, de la formation, de la relation sociale, de la culture et de l'action publique. Il s'agit d'abord d'analyser les multiples formes de fractures numériques – économiques, géographiques, générationnelles, culturelles, cognitives – qui affectent l'accès aux technologies et aux services numériques, notamment pour les publics dits « éloignés » : personnes âgées, précaires, habitants des zones rurales, personnes en situation de handicap, migrants, etc.
Les propositions pourront explorer les logiques d'exclusion ou d'auto-exclusion numérique (Gauchard, N'Goala, 2021), mais aussi les dispositifs de médiation mis en place dans les champs de l’animation, de l’action sociale, de la formation ou de l’éducation populaire.
On s'intéressera notamment aux pratiques professionnelles des médiateurs numériques, animateurs, éducateurs, bibliothécaires, acteurs associatifs, etc., ainsi qu’aux dispositifs publics ou territoriaux tels que les espaces France Services, les tiers-lieux, les fablabs, ou encore les dispositifs nationaux permettant l'accès à des oeuvres muséales (ou autres) dans d'autres communes rurales ou périurbaines. Ces formes d’accès à la culture, à l’éducation, à la sensibiltation via le numérique interrogent les conditions concrètes de mise en oeuvre, de réception et d’accessibilité, en lien avec des enjeux d’inclusion territoriale, mais aussi d'accès à l’information (Lefèvre, P. 2001).L’axe ouvre également la discussion à une lecture critique des discours technocentrés (par exemple autour de la smart city) qui peuvent masquer ou renforcer certaines formes d’exclusion, en rendant invisibles les usages différenciés ou les besoins spécifiques des habitants. Une attention particulière sera portée aux enjeux de capacitation, d’émancipation et d’autonomie dans l’accompagnement au numérique.
Axe 2 – Cultures numériques, pratiques sociales et éducation critique
Cet axe s'intéresse aux pratiques numériques des publics en contexte — jeunes (enfants, adolescent·es, jeunes adultes), mais aussi adultes, personnes âgées ou professionnel·les — à la manière dont elles participent à la socialisation, à la construction des identités, à la circulation des savoirs, ainsi qu’aux tensions qu’elles suscitent dans les sphères éducatives, familiales, sociales, médico-sociales ou institutionnelles. Il s’agit d’interroger les usages quotidiens (réseaux sociaux, jeux vidéo, création de contenus, streaming, messageries, plateformes collaboratives, etc.) dans leurs dimensions ludiques, expressives, relationnelles, professionnelles ou politiques, dans des cadres précis d’animation, de formation, de soin ou d’accompagnement social. Ces pratiques sont souvent au coeur de controverses médiatiques ou éducatives : il convient d’en proposer une lecture nuancée, fondée sur des enquêtes empiriques ou des approches compréhensives (Cordier, 2023).
L’axe invite à croiser les regards issus de la sociologie, des sciences de l’éducation, de l’anthropologie, des études culturelles ou de l’information-communication pour analyser la manière dont différents publics — jeunes, personnes âgées, professionnel·les de terrain, publics en insertion, etc. — s’approprient les outils numériques pour apprendre, communiquer, créer, se former ou se mobiliser. Cela inclut notamment les enjeux liés à la fracture numérique chez certains publics, tels que les personnes âgées (notamment en EHPAD, en résidences autonomie ou à domicile), les personnes étrangères en situation irrégulière ou précaire, les personnes en situation de handicap, ou encore les personnes en grande précarité sociale. Plusieurs de ces publics sont confrontés à une dépendance accrue à autrui pour les démarches en ligne, à une perte de lien social liée à l'exclusion numérique, ou au contraire, à des opportunités de reconnexion avec les proches et le monde extérieur grâce à la médiation numérique. Ces situations soulèvent des questions éthiques, pédagogiques et politiques sur l'accompagnement au numérique dans les dispositifs sociaux, éducatifs et médico-sociaux.
En parallèle, l’axe ouvre un débat sur les formes d’éducation critique aux médias et au numérique : quels contenus ? quelles postures ? quelles méthodologies d’animation dans les associations, les centres sociaux, les EHPAD, les établissements scolaires, les bibliothèques ou les espaces intergénérationnels (Pecolo, A., & Bahuaud, M.,2017), les lieux d'accueil des étrangers ? Cet axe veut re-penser des pédagogies critiques, inclusives et créatives, permettant d’accompagner la diversité des publics dans leurs usages numériques, tout en valorisant leurs savoir-faire, leurs cultures, leurs besoins spécifiques et leurs modes d’expression.
Axe 3 – Pratiques numériques en animation et éducation populaire : coopérations, solidarités et alternatives
Ce troisième axe propose d'explorer la manière dont les structures et initiatives de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) s'emparent des technologies numériques pour renforcer le lien social, encourager l'engagement citoyen et répondre aux besoins des territoires (Mazé & Ragueneau, 2022). Il s'agit ici de porter une attention particulière aux structures de l'animation socioculturelle, de l'éducation populaire ou de l'intervention sociale, qui partagent avec l'ESS des finalités communes de transformation sociale, de solidarité, de gouvernance partagée et d'émancipation.
Les communications attendues pourront porter sur des projets numériques initiés par des associations, collectifs, tiers-lieux ou coopératives oeuvrant dans une logique d’ancrage territorial : plateformes participatives, réseaux d’entraide, cartographies collaboratives, civictech, campagnes de levée de fonds solidaires, dispositifs de médiation ou d’inclusion numérique. Il s’agira d’interroger comment ces pratiques réalisées par des animateurs et animatrices transforment les modes d’action collective, les formes de coopération, les rapports aux publics vulnérables, mais aussi les modalités d’engagement et de participation citoyenne (Jarry-Lacombe, & al.,2022). L’axe invite également à questionner les tensions entre numérisation des services et valeurs fondatrices du travail éducatif et social de terrain, tout en s’intéressant aux modèles techniques et économiques mobilisés (logiciels libres, communs numériques, plateformes éthiques…). Des réflexions sur les conditions concrètes d’implantation de ces outils dans les structures locales, ainsi que sur leur impact écologique, devient aussi une réflexion constante et répétitive ces dernières années. Ce cadre vise à penser les formes contemporaines de l’engagement collectif à l’heure où le numérique redéfinit les capacités d’agir localement, tout en renouvelant les pratiques pédagogiques, éducatives et citoyennes.
Axe 4 – Intelligence artificielle, robotique et animation socioculturelle : les mutations en cours
Ce dernier axe interroge les enjeux socio-techniques liés à l'intégration des technologies émergentes — notamment l'intelligence artificielle (IA), la robotique, les plateformes numériques et les dispositifs de captation de données — dans les champs de l'éducation populaire et de l'animation socioculturelle. Il s'agira de questionner les finalités, les usages et les régulations de ces technologies dans des contextes éducatifs ou populaires, en examinant les tensions entre innovation technologique et valeurs fondatrices de ces champs.
Peut-on (et doit-on) remplacer un·e animateur·rice par une IA ou un robot ? Comment ces technologies redéfinissent-elles les pratiques d'animation, de médiation ou de transmission des savoirs ? Quelles sont les expérimentations en cours dans les structures socioculturelles, et comment sont-elles perçues par les professionnels ?
Les débats suscités par l'usage d'outils comme ChatGPT, les dispositifs d'animation automatisés ou les robots éducatifs interrogent directement les finalités du lien social, les formes de médiation humaine et les compétences des professionnels de l'animation. Ce questionnement invite à repenser l'avenir du secteur : quelles missions resteront indissociables de la présence humaine ? Quelles tâches pourront — ou non — être déléguées à des machines ? Et selon quelles logiques éthiques, économiques ou politiques ?
Les contributions pourront porter sur : les logiques d'automatisation de l'accompagnement humain (chatbots, robots éducatifs, IA génératives), toute réflexion et/ou expériences sur les formations à destination des animateur·rices face à l'arrivée de l'IA dans leurs pratiques, les risques de creusement des inégalités technologiques dans les territoires (nouvelle fracture numérique).
Cet axe ouvre ainsi un espace de réflexion critique sur les conditions de gouvernance démocratique et d'appropriation collective des technologies (Latzko-Toth, Proulx, 2015) dans les structures éducatives, sociales et culturelles. Il appelle à imaginer des alternatives durables, inclusives et éthiques, dans un monde où l'innovation technologique tend à s'imposer sans toujours laisser la place au débat public.
Responsable scientifique du colloque :
- VACAFLOR Nayra, Maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication, IUT Bordeaux Montaigne, laboratoire MICA .
Échéancier et modalités de soumission :
Date limite d’envoi des propositions : Lundi 3 novembre 2025 à minuit à adresser aux deux adresses suivantes :
Format attendu pour les propositions
- Longueur : 1 page, soit 2 000 à 2 500 signes (espaces compris), hors bibliographie.
- Format de fichier : Word (.doc ou .docx)
- Mise en forme : Police : Times New Roman, taille 12. Interligne : simple
Contenu de la proposition, le document devra comporter
- Un titre clair et explicite
- Le nom, prénom, les coordonnées du/de la communicant·e
- Le statut (étudiant·e, chercheur·se, praticien·ne, etc.) et organisme d’appartenance
- L’axe thématique privilégié
- Un exposé synthétique comprenant :
- La problématique générale
- Le terrain ou les données mobilisées
- Les résultats ou axes de réflexion développés
- Les principales références bibliographiques
- Téléchargez l'appel à communication dans son intégralité.