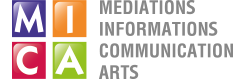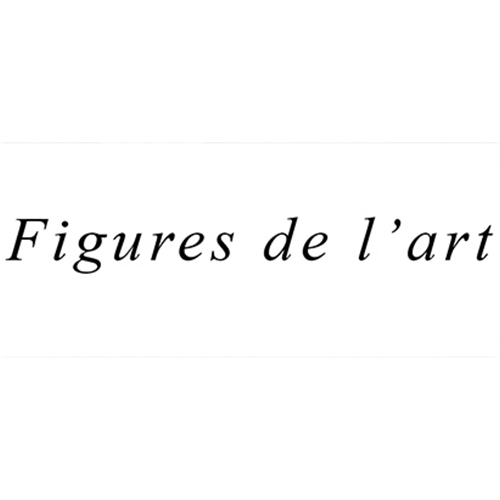Date/heure
20/06/2025
Catégories
Réparer le monde avec l’art
Figures de l'art n°44
numéro sous la direction d'Olga Kisseleva et Marie-Laure-Desjardins
Dans un contexte marqué par l’accumulation de catastrophes – pandémies, conflits armés, bouleversements climatiques, effondrements sociaux – se pose avec acuité la question du rôle que peut encore jouer l’art face à la fragilité du monde. Que peut une œuvre lorsque le corps est atteint, la mémoire vacille, ou le lien social se désagrège ? Le n° 44 de la revue d’esthétique Figures de l’art prendra pour point de départ cette interrogation, en adoptant une perspective interdisciplinaire à la croisée de l’esthétique, des sciences humaines, de la médecine et des neurosciences. Il s'agit non pas de sacraliser la pratique artistique, mais d’en examiner les capacités de transformation, d’accompagnement, et de régénération – individuelle comme collective.
L’ouvrage se propose d’explorer les dimensions sensibles, relationnelles et vitales de l’art, en tant que modalités d’attention, de résistance, mais aussi de soin.
Trois axes structurent cette réflexion.
Axe 1
Le premier axe s’intéresse à la capacité de médiation de l’art. Face à l’effondrement des écosystèmes, à l’érosion de la biodiversité, à la pollution des océans et à la disparition progressive de nombreux milieux vivants, les artistes développent des pratiques écosensibles qui agissent comme des formes d’attention et de réconciliation. Installations marines, récits poétiques des paysages en mutation, œuvres intégrant les données du vivant : autant de manières d’inscrire la création artistique dans une éthique de la réparation écologique, en proposant des dispositifs perceptifs capables de renouer les liens distendus entre humains et non-humains.
Axe 2
Ce deuxième axe interroge la fonction de l’art dans les contextes traumatiques liés aux conflits armés. Dans les zones marquées par la guerre, la violence ou l’exil, les pratiques artistiques peuvent devenir des vecteurs de mémoire, des moyens d’expression de l’indicible, voire des dispositifs de reconstruction symbolique. À travers des récits visuels, des performances, ou des formes d’archives sensibles, l’art prend part à la constitution de mémoires alternatives et participe à l’élaboration de subjectivités résilientes.
Axe 3
Le troisième axe examine les interactions entre esthétique et physiologie, en s’appuyant sur les apports des neurosciences, de la médecine et des philosophies du corps. Il s’agit d’analyser comment l’expérience esthétique – qu’elle soit visuelle, sonore ou tactile – peut contribuer à la restauration de fonctions vitales, tant sur le plan sensoriel que psychique. Cette dimension a été particulièrement manifeste lors de la pandémie de COVID-19, où l’art, même sous des formes médiatisées ou distanciées, a joué un rôle de soutien émotionnel, de continuité perceptive et de maintien du lien social. La capacité de l’œuvre à « faire présence » dans l’absence devient ainsi une question centrale de la réflexion.
Ce numéro de Figures de l’art réunira des contributions d’artistes, de chercheur·es en arts et sciences humaines, d’historien·nes de l’art, de médecins et de biologistes. L’objectif n’est pas de dégager un paradigme thérapeutique unique de l’art, mais de proposer une cartographie critique de pratiques artistiques impliquées dans des processus de réparation, qu’ils soient intimes ou collectifs, sensoriels ou politiques. Par une approche transversale, cet ouvrage entend renouveler les modes de lecture des œuvres en contexte de crise, et affirmer la pertinence de l’art dans la constitution d’un monde habitable.
Bibliographie
- Ardenne P., Un art écologique : Création plasticienne et anthropocène, Éditions Le Bord de l’Eau, 2019.
- Askenazy F., Les Psychotraumas de l'enfant, First, 2023
- Bettelheim B. Psychanalyse des contes de fées. Robert Laffont, 1976.
- Blanchot M., L’espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955.
- Chardon F., Quand l’art répare le cerveau, Paris, Dunod, 2018.
- Colignon M., De l’art-thérapie à la médiation artistique : quels professionnels pour quelles pratiques ?, Érès, 2015
- Dewey J. (1934), L’art comme expérience, trad. dirigée par J.-P. Cometti, Paris : Gallimard, Folio-Essais, 2010.
- Dubois A.-M. Art-thérapie. Principes, méthodes et outils pratiques, Elsevier Masson, 2017.
- Feneglio A. et Fleury C. Ce qui ne peut être volé. Charte du Verstohlen, Tracts Gallimard, 2022.
- Foessel M., Après la fin du monde. Critique de la raison apocalyptique, Seuil, 2012.
- Germanos Besson D. et Hillaire N., abécédaire de la réparation, Nouvelles éditions Scala, 2025.
- Glissant E., Poétique de la relation. Editions Gallimard (1990).
- Hillaire N., La réparation dans l’art, Nouvelles éditions Scala, 2019.
- Larrère C. et Larrère R. (1997), Du bon usage de la nature. Pour une philosophie de l’environnement, Paris, Flammarion, Champs essais, rééd. 2009.
- Logé G., Renaissance sauvage. L’art de l’Anthropocène, Paris, PUF, 2019.
- Lovelock J., La Terre est un être vivant, l’hypothèse Gaïa, Paris Flammarion, 1993.
- Morizot B., Sur la piste animale, Paris, Actes Sud, 2018.
- Stengers I., Résister au désastre, Marseille, Éditions Wildproject, 2019.
Modalités de proposition
Les personnes souhaitant soumettre un article (de 20 000 à 25 000 signes) sont invitées à envoyer une proposition comportant un résumé (de 250 mots), une bibliographie indicative et une courte biographie (de 150 mots) conjointement à olga.kisseleva@univ-paris1.fr et à mldesjardins@artshebdomedias.com
Les propositions peuvent être soumises jusqu’au 20 juin 2025.
Une réponse sera rapidement donnée ; la date de remise des textes est fixée au 31 août 2025, pour une publication au premier semestre 2026.